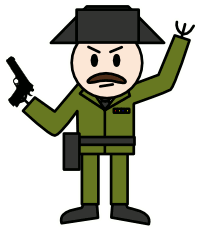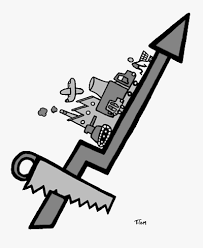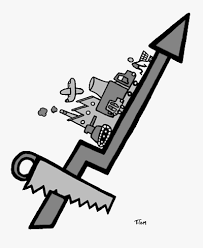
Décroissance : le poids des mots, le choc des idées (2)
http://goudouly.over-blog.com/article-decroissance-le-poids-des-mots-le-choc-des-idees-2--37213551.html
Fabrice Flipo Sur
La revue du MAUSS Alain Beitone a eu la gentillesse de m’envoyer son texte courant août. J’étais alors en route pour Delhi, je lui avais fait une réponse un peu télégraphique, avec les moyens disponibles, coincé dans une guesthouse pour cause de taxi noyé par les eaux célestes de la mousson en revenant de l’aéroport. Maintenant que je suis installé, je reprends cette réponse en la structurant mais en ne modifiant guère le fond, pour l’essentiel.
La thèse que nous défendons est contraire à celle d’Alain [Beitone], sur certains points. Nous sommes pourtant d’accord sur l’essentiel. Tout en restant modeste sur la capacité de cette « trouvaille » qu’est le mot « décroissance » à engendrer un changement social d’une ampleur suffisante pour qu’on puisse à nouveau parler « d’émancipation », nous montrons d’une part que les ambiguïtés du mot sont aussi fécondes, et pas seulement stériles, et ce n’est pas rien en l’état actuel du vide de propositions alternatives au développement-non-durable, et d’autre part que la décroissance n’est en rien contraire aux idéaux progressistes, bien au contraire car à notre sens c’est la thèse croissanciste qui désormais ne peut conduire qu’à la régression. Par souci de clarté nous avons suivi un plan proche de celui proposé par Alain, et, sommes restés sur le mode de la réponse.
Première partie : la décroissance, un terme ambigu, un projet critiquable
Ce que la décroissance dit clairement
Le terme « décroissance » est ambigu, en effet. Il dit néanmoins clairement plusieurs choses qui sont essentielles, que les autres ne disent pas. Cela déjà mérite qu’on s’y intéresse un peu, même si c’est pour s’inscrire en faux ensuite.
La première est que nous n’avons plus rien à espérer d’une croissance supplémentaire des économies occidentales, sinon une aggravation des inégalités globales, en particulier sur le plan écologique. La thèse de la « croissance verte » est fallacieuse, un examen attentif des choix techniques disponibles (énergie, agriculture etc.) montre qu’il n’y a pas de combinaison qui permette d’augmenter la quantité de production (mesurée par le PIB) en améliorant la qualité de façon à la rendre compatible avec les écosystèmes. La corrélation PIB / empreinte écologique est solide, aucune forme de développement connue ne l’a jamais réfutée. Les économistes peuvent bien reprendre leurs calculettes, le fait est là : pour produire mieux (en qualité), il faudra produire moins. Produire moins et moins vite parce que les écosystèmes, contrairement aux stocks fossiles, donnent moins et moins vite que ce qu’on cherche à prendre.
Est-ce une catastrophe ? Les partisans de la décroissance soutiennent que non, car, si on résume le propos dans des termes marxiens, on ne saurait confondre la richesse bourgeoise avec l’émancipation. Ce dont nous souffrons aujourd’hui c’est d’un trop de choses qui appauvrissent les liens. Le « moins » souhaité résulte d’un « trop » perçu, ce qui est, on en conviendra aisément, le monde à l’envers pour n’importe quel économiste car s’il y a bien une chose sur laquelle se fonde l’économie c’est que vouloir plus est rationnel. Le désir est certes infini mais il ne saurait sans se perdre sombrer dans le fétichisme de la marchandise qui nous fait prendre des biens pour des relations humaines, dans le domaine de la production sans doute, le marxisme l’a bien expliqué, mais aussi dans le domaine de la consommation, et là c’est plutôt à Baudrillard ou Marcuse qu’il faut s’en référer.
Ceci aura évidemment d’importantes conséquences sociales, qui sont habilement masquées par les thèses croissancistes qui laissent à croire que cette question peut être évitée par la seule technique. La décroissance nomme adéquatement le contexte social qui serait celui de politiques vraiment écologiques, c’est-à-dire vraiment cosmopolitiques, vraiment pour une solidarité mondiale, là où la majorité de la classe politique et des divers commentateurs s’accordent désormais tous pour vouloir « sauver la planète » - en commençant par demander au voisin d’en payer le prix. Enfin, soyons sérieux : le mode de vie des pays développés n’est pas universalisable, tout le monde le sait, et ce qu’on nous propose en guise d’universel serait davantage de croissance ? Quel tour de passe-passe ! La décroissance nomme adéquatement cet enjeu, quand « l’écologie politique », « le développement durable » etc. ne le nomment pas, pour ne rien dire de la « croissance verte » évidemment. La décroissance ne se paie pas de mots, elle ne parle pas pour chercher un consensus mou ou une position de compromis permettant une victoire électorale, laissant croire par exemple que l’écologie c’est la bobo attitude, le mieux-être, le yoga et la diététique dans des centres bioclimatiques. La décroissance pose un problème éminemment sérieux à la collectivité, et entend qu’on en débatte.
La seconde est que toutes les mesures prises pour relancer la croissance ont peu de chances de produire autre chose que des bulles spéculatives. En effet l’économie réelle n’a plus guère de marges de manœuvre, en premier lieu en raison du pétrole et des matières premières. Les économistes ont souvent des difficultés à comprendre l’aspect physique de l’économie. Les biens et les services, c’est de la matière et de l’énergie. Comme l’explique Jean-Marc Jancovici, chaque habitant des pays développés dispose en moyenne de 100 esclaves énergétiques. Quand l’énergie se raréfie son prix augmente, l’esclave et l’économie ralentissent. Là encore pour le percevoir il faut avoir une connaissance approfondie des choix techniques qui sont à notre disposition et ne pas se contenter de croire que la technique « miracle » (comme la fusion froide) nous est cachée par les capitalistes (version marxiste) ou que la flambée des prix fera apparaître la technologie adéquate permettant de continuer de croître (version néoclassique – la « backstop technology »). Cela ne marchera pas car ce qui est en jeu ce n’est pas une technique mais une infrastructure entière. Même avec une technique « miracle », c’est-à-dire une technique qui trouverait un gisement de ressources inépuisables (autrement dit le mouvement perpétuel) il faudra donc compter le temps que la technique « miracle » se diffuse, se généralise. Cette voie est une impasse. Les ressources sont quasiment toutes exploitées et la plupart proches de la surexploitation. La plupart des techniques « miracle » se contentent de déplacer les consommations sans les réduire. L’économiste doit se faire ingénieur et s’intéresser à tous ces débats « techniques » dans lesquels les mouvements écologistes sont profondément impliqués – OGM, nucléaire etc. Qu’on nous permette d’en venir directement à la synthèse : il n’y a pas, aujourd’hui, dans les divers secteurs de l’économie, de solution technique qui permette à la fois de consommer moins sur le plan écologique et de consommer plus sur le plan économique. La croissance économique se traduit inévitablement par des prélèvements écologiques supplémentaires, qui ne sont pas toujours perceptibles car ils concernent des matériaux qui sont souvent payés à bas prix dans le Tiers-monde. Les flux de matière engendrés par certains pays « développés » comme la Suisse peuvent apparemment être relativement faibles, en réalité ils sont tout aussi élevés que les autres pays développés, tels les Etats-Unis, car les pays comme la Suisse importent les produits qu’ils consomment sous une forme manufacturée. Matière et pollution sont donc comptabilisés au pays exportateur. Un tel modèle n’est pas généralisable. Et « pas généralisable » implique que l’horizon d’émancipation, d’égalité ne puisse absolument pas être atteint par ces moyens-là.
Rien à faire, la sobriété est à l’ordre du jour, et s’il y a bien une chose qui n’est ni technique ni économique, c’est bien celle-là. La sobriété, ce n’est jamais que l’autre face de la liberté des autres. Un problème politique, donc.
De ce fait en aucune manière la croissance de l’économie ne peut plus être compatible avec l’émancipation. Le terme « décroissance » dit un engagement : celui d’aller vers des sociétés de décroissance, et pas seulement de croissance verte ou de croissance responsable etc. qui sont sinon des oxymores du moins des termes encore plus ambigus, pour ne rien dire du « développement durable ».
Sur l’ambiguïté du terme
Sur d’autres points, le terme de « décroissance » est ambigu. Mais cette ambiguïté est fertile, nous allons ici le prouver par quelques exemples.
Le premier porte sur la définition de l’économie. On entend souvent dire que les mouvements de la décroissance parlent de « l’économie » sans faire la distinction avec « l’économie capitaliste » ou avec « le développement ». Sur le premier point on peut répondre en deux temps. Le premier est historique : les économies socialistes réelles ont toujours été des économies de croissance. Le second temps est conceptuel : du côté socialiste, personne ne propose de théorie « économique » de la décroissance, ou même de la non-croissance. Une telle théorie d’ailleurs ne serait probablement plus une « économie ». Ne nous payons pas de mots : la « décélération de la croissance » proposée par le livre du conseil scientifique d’Attac sur le développement joue au niveau du détail [1] - quand on est à 1-2% de croissance, que signifie de décélérer encore sans engager la question d’une décroissance ? On pinaille. Une décroissance « sélective », comme le propose notamment par Jean-Marie Harribey [2] ? C’est soit une évidence, du point de vue politique, des mouvements de la décroissance dont aucun ne soutient la décroissance aveugle de tout et n’importe quoi, soit c’est une question, et non une réponse, sur le plan de la théorie économique, car tout le monde sait d’une part que les secteurs sont interdépendants et qu’on ne peut pas faire son marché ici et là comme on a cru pouvoir le faire en URSS sans provoquer de désorganisation, et d’autre part cela ne dit absolument rien du lien social qui serait à la base d’une telle réorganisation. D’où viendraient ces « choix » ? De lois ? A quel niveau ? Quel serait le statut de l’initiative privée ? La perspective de la décroissance ouvre des questions qui ne sont abordées quasiment nulle part – si tel n’est pas le cas alors que l’on nous détrompe à ce sujet.
La question d’une croissance zéro a bien été posée mais rarement celle d’une décroissance. Une décroissance ce n’est pas une stabilisation mais une réduction, pour aller vers une stabilisation qu’il reste à préciser. Après 150 ans de croissance continue dans nos pays il convient de mesurer toute la nouveauté de cette réflexion – une réflexion que les opposants comme Harribey ou autre se gardent bien d’engager, préférant des termes bien plus ambigus. Répartir les « gains de productivité » pour réduire le travail ? Il y a là plusieurs objections à faire, et nous espérons que l’on prendra un peu le temps d’y penser avant de les récuser en bloc sur le mode de la polémique. Premièrement si ces « gains de productivité » existent c’est parce qu’il existe aussi un système technique productiviste qui les produit, tout ça ne sort pas de nulle part. Pour continuer de les partager, on doit donc supposer que l’on maintient ce système technique – donc que l’on maintient l’économie à des niveaux insoutenables. Deuxièmement réduire le travail humain ne changera guère le résultat final, ou alors il faudrait un peu le chiffrer. On travaille déjà assez peu par rapport à d’autres pays, comment pourrait-on encore réduire de beaucoup sans avoir à faire face non pas à un ralentissement de la même machine productive mais à une reconfiguration totale de la machine productive ? Ce qui dans ce cas-là n’exclut pas de réduire le travail humain, mais, et c’est là un troisième point, la réduction du temps de travail est une mesure simplement négative : elle ne débouche sur rien de positif, aucun nouvel élan. C’est le « mauvais infini » de Hegel : à un terme en est opposé un autre, il manque la négation de la négation qui permet leur dépassement. En outre l’élection de Nicolas Sarkozy a montré que la RTT n’était pas porteuse sur le plan politique, il convient, loin de tout dogmatisme, de se demander pourquoi.
Les mouvements de la décroissance répondent à cette interrogation en prenant le problème dans l’autre sens. Ils estiment pour une large part que la réduction du temps de travail est à court terme moins prioritaire que la critique du productivisme et en particulier du consumérisme car c’est ce dernier qui obère tout soutien populaire à une réduction du temps de travail, entretient le productivisme et le « travaillisme ». Ceci conduit à interroger le concept de travail plutôt que de vouloir simplement en réduire l’importance dans la journée de vie. Le productivisme a défini le travail comme une « relation à la nature » réputée hostile. Il y a des besoins tyranniques et des matériaux pour les satisfaire par l’intermédiaire de l’effort : tel serait notre lot. Pourtant il n’y a pas de « relation à la nature » qui soit donnée sans médiation symbolique. Définir le travail comme une « économie de temps » comme le fait Jacques Bidet par exemple [3] implique forcément une anthropologie des besoins croissants. Dans bien des activités on ne peut tout simplement pas « gagner de temps » car cela se fait au détriment de la qualité. L’enjeu de la discussion est là.
Vous dites que les partis politiques hésitent à utiliser le terme car il n’est pas populaire. D’accord. Cependant la croissance est populaire et cela n’en fait pas pour autant une solution en termes d’émancipation. Un programme qui ne serait composé que de mesures populaires pourrait être plus populiste qu’émancipateur – autrement dit la difficulté que rencontrent des politiques comme Yves Cochet pour porter ce message ne prouvent rien sur leur qualité intrinsèque ni même sur leur potentiel à venir. Trotsky dans son Histoire de la révolution russe ne s’arrête pas au fait que les masses n’ont pas encore compris le socialisme ; les libéraux ne s’arrêtent pas davantage sur le fait que l’homme économique est une totale abstraction pour le commun des mortels. De plus on ne peut pas penser uniquement en termes de stratégie de parti politique – et encore moins de stratégie pour un parti politique dominant. La décroissance vient avant tout de la société civile, d’un monde plutôt associatif, elle crée un rapport de force avec les partis, qui ne feront rien sans cela.
Le terme est négatif ? Mais « anticapitalisme » l’est tout autant, et pourtant on ne voit guère le NPA l’abandonner, ni d’ailleurs trouver facilement de solution pour le remplacer.
Le terme ne semble pas désigner de projet de société ? Sans doute, mais qui en propose un clé en main aujourd’hui ? L’anticapitalisme ne dit rien non plus. « Socialisme » se cherche, c’est le moins qu’on puisse dire, et « communisme » est devenu synonyme d’Union Soviétique – dans le grand public. « Décroissance », comme « écologie » a l’avantage de la nouveauté. Il intrigue, qu’on soit d’accord ou pas et d’ailleurs vous en êtes d’accord quand vous dites que « cette proposition détonne dans le débat public et interroge ». Un débat sur le développement durable ne détonne plus du tout, et on se demande si ça interroge encore. Les débats publics sur la décroissance organisés par Attac réunissent habituellement 2 à 3 fois plus de personnes que les autres, événements conjoncturels (sortie d’un livre, krach d’une banque etc.) mis à part. Ils attirent des gens qui ne sont pas dans Attac, qui viennent d’horizons très différents - quoi de mieux pour sortir des chapelles et retisser le commun ? Le mot-obus réussit donc en partie à poser des débats que d’autres ne parviennent pas à poser, et je crois que ceci peut être justifié par l’expérience acquise dans ce genre de débat – mais là encore nous ne demandons qu’à être détrompé. Il faut donc le porter à son crédit. Bien sûr certains publics ne viendront jamais, pour différentes raisons, mais à ce jour aucun thème ne parvient à susciter un engouement universel. Tout en mesurant l’intérêt du débat sur la décroissance il convient donc de rester modeste par rapport à ce qui serait requis pour amorcer un véritable changement à grande échelle.
Sur la critique de la croissance
Vous dites que le PIB n’est pas un indicateur de bien-être. C’est vrai sur le plan scientifique, celui du débat entre économistes, mais c’est faux sur le plan politique et même social : le PIB est de fait utilisé comme indicateur de bien-être ou comme une condition nécessaire de tout progrès du bien-être. C’est de ce fait que part la décroissance, pas des débats de spécialistes et en particulier des débats d’économistes qui sont pour la plupart, quelle que soit leur obédience politique, hostiles à la décroissance – ce qui en soi indique quand même quelque chose d’intéressant au sujet des présupposés qui fondent la corporation ! A tous les problèmes une seule solution : la croissance. C’est contre ce fait que se mobilise la décroissance, pour arriver à briser la chape de plomb médiatique et montrer que non, la croissance au sens commun du terme c’est-à-dire la croissance du PIB ne va ni vers le bien-être ni vers l’égalité. Qui d’autre peut se vanter d’arriver à poser une telle question ? A nouveau nous ne demandons qu’à être détrompé.
Décroissance ou capitalisme vert
Vous montrez que Marx a critiqué l’accumulation, fort bien, mais outres les arguments cités plus haut à l’encontre des marxismes et des socialismes historiques la question est de savoir si Marx a proposé un critère permettant de définir à partir de quand l’accumulation devient une oppression. La réponse est non – et là encore nous cherchons encore un contre-argument valable, les pages universellement citées du Capital ou des Manuscrits telles que « la terre et le travail sont les deux sources de la richesse » sont bien trop imprécises pour vouloir dire quelque chose de concret.
Moishe Postone, dans un ouvrage dont la parenté avec la décroissance a été perçue par les observateurs attentifs [4], montre de manière convaincante que le Marx de la maturité a bien perçu que le « règne de la valeur » dépendait d’une certaine conception du travail et d’une certaine forme de richesse – en découle donc une certaine conception de « la productivité » puisque celle-ci mesure la quantité de cette richesse-là produite par heure de ce travail-là. Postone affirme que Marx avait perçu que l’abolition de la valeur exigeait l’abolition de ce travail-là et de cette richesse-là [5]. Or ce qui s’est produit historiquement est que le marxisme et les régimes socialistes ont au contraire voulu abolir la valeur tout en conservant la forme bourgeoise de richesse et de travail. Il en a résulté l’URSS. Il en a aussi résulté que les marxismes ont indéfectiblement soutenu le mouvement ouvrier, et snobé toute autre forme de lutte. Postone lui voit de l’avenir dans les mouvements féministes, écologistes etc. qui lui semblent porteurs d’une autre forme de travail et de richesse, et reposent donc sur un concept différent de la valeur.
Pour notre part nous pensons que la théorie de l’exploitation de Marx garde toute son actualité mais elle doit notamment être complétée par une théorie de l’exploitation de la nature. Une telle théorie s’ancre dans la nature comprise comme res communis, nous avons eu l’occasion de l’expliquer dans un ouvrage paru chez Parangon [6]. Marx n’aborde pas cette question, c’est un fait dont on doit tenir compte. Les marxismes ne l’abordent pas davantage. Quand ils abordent la question écologique c’est en général pour l’imputer aux excès du capitalisme. C’est un peu court, et encore une fois c’est le mauvais infini, la négation sans le dépassement. Il me semble un peu facile de se cantonner au « travail du négatif » en attendant que d’autres – l’Histoire, peut-être - retournent dialectiquement la situation ! Le problème est de savoir à quoi ressemblerait une société qui ne serait pas une société d’accumulation, et donc pas une société de croissance, ce que la décroissance se propose de rechercher.
Qu’il y ait un autre socialisme possible peut-être, cela reste à démontrer ; que le terme « socialisme » soit adapté reste tout autant à démontrer ; en tout cas toutes ces batailles sur les en-têtes de programme ne devraient pas obérer ni dispenser de réflexions plus approfondies sur le contenu. La décroissance apporte bien une posture nouvelle, qui ne peut se confondre ni avec le capitalisme de marche ni avec le capitalisme d’Etat – si par « capitalisme » on entend l’accumulation de capital, sous quelque forme de propriété que ce soit.
« Décroissance », une incantation pas un projet politique
La décroissance ne prétend pas avoir réponse à tout. Elle prétend ouvrir des débats que les autres n’ouvrent pas, et proposer des solutions que d’autres ne proposent pas, c’est différent. Vous vous demandez comment on va gérer les effets d’une forte réduction de l’usage de l’automobile ? Ce n’est pourtant que la conséquence d’une politique d’égalité mondiale menée de manière conséquente ! Ou alors expliquer par quel miracle il serait possible à l’avenir de mettre 5 ou 6 milliards de voitures en circulation, et avec quoi on les fera avancer. La question qu’il convient de se poser est plutôt de savoir pourquoi la gauche bien-pensante, sûre de sa conception du progrès, n’a jamais défendu ce genre de mesure.
A l’inverse pour notre part nous ne pouvons qu’être indignés par plusieurs propositions qui sont faites dans cette partie de votre texte, en tant qu’elles se réclament du progressisme – une qualité que nous ne leur reconnaissons pas, pour notre part. Ainsi d’après vous il faut des riches acheteurs de bananes au Nord pour que le Sud puisse vivre ? C’est un argument réactionnaire du même tonneau que celui qui veut défendre le personnel de maison pour créer des emplois. Vous n’êtes pas de ce bord mais vous devez vous rendre compte que la plupart des indignations qui sont les vôtres ici peuvent être considérées comme relevant de la défense des privilèges de nantis, sur le plan des inégalités planétaire.
Ce qu’il vous faut comprendre est qu’une réponse de grande ampleur à la crise écologique et/ ou aux inégalités passe par une décroissance. Que cela soit à la fois politiquement inédit et difficile, personne n’en disconvient ; ce qu’il faut saisir est que les autres propositions sont utopiques au mauvais sens du terme – autrement dit, elles ne vont pas vers l’émancipation.
Faut-il diaboliser le développement durable ? Non bien sûr mais comment ne pas voir que ce terme est devenu totalement flou ? « Décroissance » est ambigu, mais au moins l’est-il beaucoup moins, relativement à ce qu’il veut dire – et il n’entend pas tout dire !
Le développement, ce n’est pas la croissance ?
François Perroux est toujours cité pour argumenter sur la différence entre croissance et développement, voilà un argument classique. A cela deux remarques préliminaires. D’une part Trotsky, bien avant Perroux, et même Hegel, faisaient déjà cette distinction. Perroux, comme économiste, n’en propose qu’une version issue de l’économie comme discipline, c’est-à-dire appauvrie, sectorielle – à part la liste à la Prévert (des écoles etc.) on serait bien en mal de préciser ce que Perroux entend par « développement », quand ça commence et surtout où ça s’arrête, en termes de croissance des besoins. D’autre part le contre-argument avancé par Perroux est considéré comme non-convaincant par la majorité des mouvements de la décroissance, pour des raisons qui tiennent justement non pas à ce que Perroux a dit mais à ce qu’Hegel ou Trotsky ont pu dire bien avant lui. Pour que Perroux convainque il faudrait qu’il réponde à la question posée plutôt que de servir d’autorité morale. Relisez l’Histoire de la révolution russe. Que dit Trotstky au sujet du développement ? A quoi se réfère-t-il ? Pourquoi parle-t-il de « stades » successifs, comme Rostow, quoi qu’avec des buts très différents ? On ne peut pas utiliser les mots en ignorant leur sens. « Développement » est un terme problématique car il est très largement synonyme d’un développement économique – c’est-à-dire de la croissance. Même l’ONU en convient [7]. Le développement économique c’est la division du travail, l’évolution des techniques et la production croissante, ainsi que l’idée que toutes les sociétés finiraient un jour par connaître le même état « développé » - le nôtre, il suffit de constater quels sont les pays considérés comme « développés » à l’ONU pour s’en rendre compte. Les catégories utilisées dans l’espace international sont très claires : quand on parle de « sous-développement » ce n’est qu’en relation avec ce que sont les pays « développés ». Uniquement cela.
Bien sûr dans le détail cela fait des décennies que tout le monde s’accorde sur le fait qu’il existe des trajectoires différentes en fonction du passé et des conditions naturelles propres à chaque pays, là n’est pas le problème. Perroux, dans la citation que vous proposez, de manière significative, ne propose aucun critère permettant de dire à partir de quel seuil les « coûts de l’homme » (expression que nous n’emploierions jamais pour ma part !) sont « suffisants » - or c’est la tout le débat si on veut sortir d’une société de croissance, c’est-à-dire de croissance illimitée. A l’inverse tous les théoriciens de la décroissance tentent d’évaluer le « suffisant ». On comprend que les riches et ceux qui s’enrichissent trouvent que ce genre de réflexion est insupportable. Perroux dit qu’il peut y avoir croissance sans développement, fort bien, tout le monde est d’accord, le Cauchemar de Darwin l’illustre à merveille, mais peut-il y avoir du développement et de la décroissance ? Car il ne peut y avoir de « développement » au sens où vous l’entendez si tous les pays du monde veulent ressembler à la France, la planète n’y pourvoira pas et ce n’est pas quand cela deviendra évident, à coups de millions de morts et de réfugiés, qu’il faudra y penser. C’est là la question posée par la décroissance.
Enfin le fait que la majorité de la population mondiale ne soit pas touchée par la propagande consumériste – ce qui reste à voir - ne dispense pas d’avoir à sérieusement la remettre en cause dans les zones où elle sévit, n’est-ce pas ? Par contre le prétexte de la pauvreté peut très efficacement servir à défendre des politiques de croissance qui in fine ne profitent qu’aux riches.
Le résultat que vous proposez en conclusion de la partie 1 est sans doute juste mais ne coûte rien car il se contente de reprendre un discours qui peut tout aussi bien être celui de la croissance verte capitaliste. Pour ne prendre qu’un exemple : n’importe quel manuel de marketing évoque lui aussi la valeur d’usage comme élément requis pour que la vente puisse se faire. Marx le disait déjà, d’ailleurs. Vous restez donc totalement dans l’ambiguïté.
Seconde partie : la décroissance est-elle réactionnaire ?
L’argumentation proposée jusqu’ici répond déjà en partie aux objections qui se font jour dans cette partie. La thèse de la décroissance est que c’est le projet de croissance qui est aujourd’hui incompatible avec un projet « de gauche » ou disons plutôt « progressiste ». Sans doute un tel projet était-il compatible dans les années 1920 ou est-ce encore le cas dans d’autres pays moins développés sur le plan économique. Mais ce n’est plus le cas en France ni dans aucun autre pays développé. Et c’est à ce public que la décroissance s’adresse en priorité.
La place manque pour s’attarder sur les écrits de Jean-Marie Harribey et de Cyril Di Méo. Je n’en retiendrai ici qu’un point : les mouvements de la décroissance ne se reconnaissent généralement pas dans la présentation qui est faite de leur action, il suffit de lire leurs écrits pour voir comment ils s’estiment trahis par ce genre de littérature. Nous avons proposé ailleurs une lecture différente de ces mouvements [8]], qui a le mérite de recueillir leur assentiment. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que nous pouvons expliquer les mouvements par leur inconscient, notre rôle se borne à prendre acte de leur existence telle qu’elle se définit. Le reste est querelle politicienne et lutte de pouvoir, ce n’est pas un travail d’analyse prétendant à l’objectivité.
La première question que vous posez est celle de la pluralité du bien. La première remarque que nous ferons, en préalable, est que ce pluralisme est une exigence libérale. Le préciser a pour but de mettre votre exigence en regard de l’appel à l’autorité de Marx qui a été le vôtre plus haut. Marx n’a pas pensé le pluralisme, c’est pour cette raison qu’Habermas a écrit sa Théorie de l’Agir Communicationnel, d’une part, et que Jacques Bidet a écrit sa Théorie Générale, de l’autre : pour mettre en évidence deux autres facteurs-de-classe que sont l’inégal accès à la parole effective (acte dit « illocutoire », accompagné d’effets sur les normes communes) et l’inégale position dans l’organisation bureaucratique. Les mouvements de la décroissance pour une large part souscrivent à ces révisions qui peuvent paraître comme un infléchissement vers le libéralisme. Mais ils portent deux critiques, des critiques qui ne sont pas nouvelles mais auxquelles la décroissance donne un nouvel élan.
La première est que la décroissance souscrirait à l’objection que Rawls fait à Habermas, en ceci qu’une théorie de la justice ne peut en aucun cas être purement procédurale [9]. Toute « société » se fonde sur des valeurs partagées, dit Rawls. Et l’idée selon laquelle la croissance est forcément un bien par exemple est une idée qui repose sur des valeurs et non sur des faits. Le problème est que les sociétés modernes en ont fait un fait de science – de science économique, car l’économie n’est autre que la science de la croissance, de l’évolution « Pareto-optimale ». Une économie stable est une expression devenue synonyme d’économie de croissance stable. Et las ! Les sciences sociales ont aussi assez largement profité et défendu la croissance, en s’accordant finalement pour ne jamais revenir sur les progrès apportés par la division du travail et la « différenciation » qui caractériseraient en propre la modernité – cf. Durkheim, Tönnies, les socialistes « utopiques », la naissance de la « sociologie » etc.
Le problème est double. D’une part ces sciences n’ont guère produit de critère permettant de mettre en évidence un seuil au-delà duquel la différenciation pourrait être jugée « excessive » et « contre-productive ». En l’absence d’un tel critère la différenciation et donc la division du travail et donc la croissance ne connaissent pas de limites – sinon le « marché mondial » ou « l’abondance » dont parlait Marx de manière fort vague dans la Critique du Programme de Gotha. Diverses composantes de la décroissance tentent au contraire de montrer qu’il existe un point, un « seuil » pour reprendre les termes d’Illich au-delà duquel la différenciation échappe à la société et la détruit. Il convient tout de même de s’attarder sur cette thèse si on s’intéresse à la démocratie, à l’égalité, à l’émancipation ou même seulement à l’écologie. D’autre part ces « sciences », de par leur prétention, soustraient une théorie du bien au débat public pour la naturaliser. La modernité, qui se vit et se définit, comme vous, dans l’illusion d’une liberté purement procédurale, s’en trouve assurément choquée. Mais comment accepter que « toujours plus » (de consommation) soit un état normal ? La décroissance dénaturalise, dévoile, démasque. En fait la décroissance introduit du pluralisme au-delà de ce que peut accepter la modernité telle qu’elle est généralement définie (ce qui ne veut pas dire qu’il faille y adhérer). La modernité maintient en réalité son « pluralisme » dans les étroites limites de ce qui peut servir sa croissance. Vous avez le droit de tout désirer, de tout proposer, sauf que cela dessert la croissance. L’oppression vient donc de cette dictature du Bien, ce Bien qu’est la croissance. La décroissance n’entend donc pas faire une OPA sur le bien au détriment du juste, elle entend plutôt dénaturaliser le bien.
Un second point est à souligner. La modernité ne se définit pas seulement par la différenciation croissante mais aussi par la séparation entre privé et public. Dans la théorie marxiste les besoins sont définis par le peuple sans que soient précisées les modalités institutionnelles qui puissent le garantir. Dans la social-démocratie les choix se font à moitié par le marché et à moitié par l’Etat et le secteur public, généralement en charge des « biens publics ». Dans le libéralisme économique le marché est le lieu premier du choix. De manière schématique, trois théories et trois lignes de partage entre public et privé. Ce qui vous choque probablement dans le fait que les objecteurs de croissance proposent publiquement d’utiliser le vélo à la place de la voiture est que ce choix est réputé appartenir à l’ordre du choix privé.
Là encore deux remarques. La première est qu’une telle ligne de partage est libérale. Dans une économie socialiste on ne voit guère comment on pourrait définir collectivement les besoins de chacun s’il est interdit d’en parler car cela relève de la sphère privée. La seconde est que ces « choix » individuels, qu’ils soient considérés comme privés ou publics, ne s’exercent désormais que dans d’étroites limites physiques et idéologiques. Des limites physiques, du fait de l’omniprésence des « macrosystèmes techniques » [10] : quand vous habitez une zone pavillonnaire le vélo est exclu du choix. Des limites idéologiques, qui expliquent qu’une multiplicité de choix privés et « pluriels » aboutit quand même à de longues files devant les boutiques Orange la veille de la sortie de l’Ipod. Le fait que la pluralité théorique se réduise ainsi à un nombre de choix qui en pratique est limité et orienté dans une direction précise (celle du « développement des forces productives ») doit interroger.
Les objecteurs de croissance, comme mouvement politique font des propositions. Tous les partis proposent plus de trains, d’avions, de voitures et de vitesse. Le parti de la décroissance est le seul (avec les Verts) à en proposer moins. Evidemment si l’on croit qu’on en manque alors on trouvera cela insupportable ; par contre si on pense qu’on en a trop alors voilà enfin une offre correspondante ! Les objecteurs de croissance proposent de se réapproprier collectivement l’utile et l’inutile pour éviter que le marché et l’Etat productiviste ne décident à la place des citoyens, en nous convainquant chacun et chacun(e) individuellement du bien-fondé du « plus consommer » - mais en occultant les conséquences collectives. Quand avons-nous « choisi » de dépendre du système automobile [11] ? Et pourtant les choix « privés » et « pluriels » des citoyens sont massivement contraints par la nécessité d’avoir le permis et un véhicule. Le mouvement de la décroissance pense qu’il y a une aliénation organisée dans la société de croissance, et en cela elle reprend le flambeau du freudo-marxisme, de Baudrillard, bref des filiations qui n’ont jamais été considérées comme réactionnaires. Les mouvements de la décroissance proposent d’autres modes de consommation et aussi d’autres modes de production, vous êtes libre d’en choisir et d’en proposer d’autres mais ce qui serait intéressant serait de connaître les conséquences de vos choix et propositions sur le plan des inégalités globales, et les comparer aux justifications produites par les objecteurs de croissance dans le choix de leurs pratiques. Là on verrait qui est réactionnaire. La publicité propose à longueur de journée des modes de vie désirables et le public se croit libre de les désirer. Pourquoi aurait-elle le monopole ? Pourquoi « le social » se réduirait-il à assurer le droit de participer aux macrosystèmes techniques lorsqu’ils sont devenus obligatoires – et donc facteur d’exclusion ? La décroissance montre en actes qu’on peut désirer autre chose et qu’on peut imaginer des politiques publiques qui permettraient de faciliter ces modes de vie.
Sur le plan de l’articulation entre le bien et le juste, c’est donc l’objection de croissance qui est moderne – et c’est la modernité qui ne l’est pas !
Sans doute effrayé par l’idée d’une réduction de la consommation, que la décroissance voit comme une voie vers l’émancipation, vous citez l’ascétisme des moines cisterciens. C’est là une caricature que vous élevez en repoussoir, car aucun courant de la décroissance ne propose de reconstruire des monastères – ou alors veuillez indiquer qui porte un tel programme.
La question est de savoir ce qui vous pousse ainsi à caricaturer les propositions des objecteurs de croissance, et savoir aussi pourquoi cette caricature revient aussi souvent, surtout chez les économistes. Peut-être est-ce parce que la simple idée de limite ou de « suffisant » leur semble insupportable et en cela ils incarnent bien la modernité au sens dominant du terme ; il reste à savoir si les convictions progressistes iront jusqu’à affronter la réalité, à savoir qu’un tel refus de toutes limites rime avant tout avec la loi du plus fort. Un citoyen Français ne serait guère solidaire de l’humanité s’il maintenait de telles affirmations.
La question de l’urgence est facile à aborder. Bien sûr l’argument peut faire le lit de mesures autoritaires, mais c’est là occulter le fait que de nombreux partis brandissent l’argument de l’urgence, notamment l’urgence de favoriser les conditions d’une reprise de la croissance, sans pour autant devenir autoritaires. La question est de savoir si vous, nous, tous, nous pensons que la planète, l’égalité etc. peuvent attendre encore un peu.
Que la décroissance mette en cause l’idée de progrès telle qu’elle a été définie par le croissancisme est une évidence. Le débat s’ouvre à partir du moment où l’on accepte de ne pas fétichiser ce progrès et en faire un absolu. Les mouvements de la décroissance n’ont pas le monopole des propositions alternatives. Mais les mouvements de la décroissance sont les seuls à essayer de penser au-delà de la croissance et donc du capitalisme au sens où Marx l’avait entendu, même s’il n’en a pas développé toutes les implications.
Que cela ouvre aussi la porte à la réaction, sans doute, mais il ne faut pas tout confondre non plus, la réaction a aussi, et depuis longtemps, été anticapitaliste, pour autant on ne l’a pas systématiquement rangée avec le parti d’Alain Krivine ou celui d’Arlette Laguiller.
Vous dites qu’il faudrait mesurer toutes les conséquences d’une remise en cause radicale ? Nous disons oui, en effet, mesurons-les, c’est là le débat que veut la décroissance – qu’on adhère ou pas à ses organisations.
Vous dites que « La gauche a toujours considéré que le présent n’était pas fatal et que le retour en arrière n’était pas un idéal ». En effet par conséquent la croissance n’est pas fatale ! Et la décroissance ne propose pas de retour en arrière – sauf à occulter, encore une fois, les conséquences infiniment régressives qu’une poursuite de la croissance aurait sur l’humanité actuelle et à venir. En fait, il s’agit plutôt pour ces mouvements de ne pas adopter béatement les « progrès » apportés par le capitalisme et de ne pas non plus systématiquement dénigrer les pratiques et les techniques populaires issues de sociétés qui ne jouissent pas de notre aisance matérielle – car ces techniques ont peut-être d’autres vertus, écologiques et conviviales par exemple.
Au fond, la question à se poser, en termes marxiens, est celle-ci : avec « l’intégration fonctionnelle » des classes ouvrières dans la bourgeoisie mondiale des classes moyennes, ne confond-t-on pas, quand on assimile décroissance et régression, progrès et richesse bourgeoise ? Convenir qu’une certaine forme d’austérité est la seule compatible avec une égalité globale rejoint pourtant les revendications des organisations qui demandent de limiter l’échelle des salaires – pour porter cette revendication de l’échelle nationale à l’échelle globale, d’un pays nanti à un monde qui est loin de l’être. Ou alors si le progrès implique d’atteindre un PNB de 20 000 euros ou plus par habitant, il faut avoir le courage de dire que la majorité de l’humanité sera broyée par la minorité qui seule peut parvenir à atteindre ce but. Et revendiquer cette égalité qui fut celle de Marat n’implique pas automatiquement d’adhérer à sa stratégie qui fut celle de la guillotine.
Sur la question plus politicienne des alliances, cela reste à voir. Indéniablement la décroissance pose un problème de positionnement, néanmoins aucun parti de gauche n’est indemne de ce genre de problème de nos jours !
Sur la science
Là encore les éléments donnés plus haut constituent une première réponse. Si par « science » on désigne un corps de spécialistes chargés de déterminer le vrai, et que ce vrai implique une croissance illimitée, on voit tout de suite le problème que ça peut poser en termes de démocratie et d’émancipation. Si on voit que les projets de recherche poursuivis par « la science » peuvent généralement se caractériser par un approfondissement de la division du travail qui suppose forcément de la croissance (centrales nucléaires, OGM etc.), alors on ne peut pas se satisfaire d’une équation science = progrès. Et il ne suffit pas de faire « un usage raisonnable » de cette science-là, car son développement implique l’éradication d’autres savoirs, d’autres projets de recherche, car elle absorbe les moyens financiers et humains (en termes de formation etc.).
Vous êtes professeur d’économie donc vous savez que la différence entre la « durabilité faible et la « durabilité forte » porte justement sur l’espoir dans le progrès des sciences et techniques. Cela ne peut être une coïncidence. C’est au contraire un point clé. Et la critique des « têtes pensantes » qui font la science officielle (Claude Allègre...) au motif qu’elles pensent mal ou de manière autoritaire ne conduit pas à affirmer que le savoir n’a aucune valeur, que tout se vaut, que la croyance vaut bien le savoir. Bien au contraire, il s’agit de démocratiser la science et de refuser la séparation profane / sacré que nous propose la science dominante. Il s’agit de défendre Galilée contre l’Académie des Théologiens (de la croissance). Et combattre la Raison quand elle se fait Raison d’Etat ou dictature des savants, le Grand Récit de l’homme prométhéen étant chargé d’asseoir dans les « cerveaux disponibles » par la publicité l’équivalent du « noble mensonge » platonicien.
Les faits que vous évoquez sur Diderot, la dissection, le Vatican etc. sont sans doute exacts mais n’ont pas de rapport direct avec la problématique de la décroissance ni avec ce qui est précisément mis en cause dans la science telle qu’elle existe aujourd’hui. Ou alors il faudrait préciser. C’est un effet de style destiné à inscrire vos propos dans ce qui se présente comme le combat universel de la lumière contre l’obscurité. Sur le fond, ce n’est pas avec les batailles du passé qu’on construit celles de l’avenir. Il est bien clair que les attaques contre le savoir émancipateur ne viennent plus des mêmes endroits qu’il y a 500 ans, ni de la même manière. Il convient aussi de ne pas fétichiser « la science » et tenir pour vrai tout ce qui se présente comme tel. Ce ne serait guère honorer les Lumières et l’appel de Kant qui résume le projet : « Ose penser par toi-même ! ».
Quelques mots sur le relativisme, avant de conclure. C’est un sujet difficile qui n’est abordé dans votre texte que de manière polémique. Un fait doit pourtant être souligné : le fait que les Occidentaux se proclament les seuls détenteurs de la science et de la rationalité, et ceci en dépit du fait qu’ils ont mis en place un système social qui ne peut être universel que sur le plan formel, déclaratif, et non réel, ne peut que choquer. Si l’on accepte cette prémisse qui revient finalement à dire que l’intelligence est quand même quelque chose de partagé alors les sociétés « non-développées » doivent être regardées avec un tout autre regard que celui qui ne voit en elles que notre propre passé et ce qui lui manque pour être « dans le présent », pour être « up to date », « world class » comme on dit un peu partout.
Pour autant inverser la problématique serait tout aussi réducteur. Si nos sociétés ne sont pas les seules qui soient porteuses de l’universel, les sociétés « primitives » ou autres exemples existants ne le sont pas d’emblée non plus, en tout cas pas sans examen approfondi. On trouve parfois dans la décroissance – comme dans l’écologie du reste – un certain contre-pied qui voudrait que ce que la modernité a posé comme son contraire – la société primitive – soit, de l’Enfer, désormais devenu le Paradis. Quand il s’agit d’enfer et de paradis, on comprend que les échanges soient vifs. Dès qu’un objecteur de croissance concède quoi que ce soit aux sociétés primitives, le Moderne cherche à l’occire de ses foudres et dénonciations. Dès qu’un Moderne cherche à trouver quelque intérêt aux techniques existantes, un objecteur de croissance va procéder de même. Ces passes d’armes, qui versent de part et d’autre dans l’hubris que l’on dira bien latin, ne doivent pas occulter les enjeux eux-mêmes.
Pour autant, gageons les paris que l’opposition primitivisme / croissancisme prenne de l’ampleur dans l’avenir, car c’est elle, et elle uniquement, qui permettra de trouver une alternative qui ne soit ni le développement ni le sous-développement.
Conclusion
Finalement ce qui nous sépare n’est peut-être qu’un débat extra-économique, portant avant tout sur la modernité, d’une part, et sur les choix techniques, de l’autre. Cette lettre fut un utile point de départ pour esquisser quelques clarifications et faire progresser le débat, soyez-en remercié.
Notes
[1] J.-M. Harribey (dir), Le développement a-t-il un avenir ?, Mille et Une Nuits, 2004.
[2] J.-M. Harribey, « Développement ne rime pas forcément avec croissance », Le Monde Diplomatique, juillet 2004.
[3] Jacques Bidet, Théorie Générale, Paris, PUF, 1999, p. 56
[4] Le Monde des Livres, 13 février 2009.
[5] M. Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et Une Nuits, 2009.
[6] Fabrice Flipo, Justice, nature et liberté, Lyon, Parangon, 2007.
[7] ONU, UN contributions to development thinking and practice, Indiana University Press, 2004.
[8] [->http://www.journaldumauss .net...
[9] J. Rawls et J. Habermas, Débat sur la justice politique, 2005.
[10] A. Gras, Les macrosystèmes techniques, Paris, PUF, 1997.
[11] G. Dupuy, La dépendance automobile, Paris, Economica, 1999.