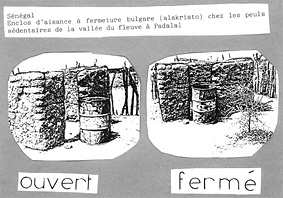Les débats sur la Responsabilité de Protéger (Responsability to Protect – R2P), ou sur son cousin « l’intervention humanitaire », sont régulièrement perturbées par la présence d’un cadavre dans le placard, la question taboue, à savoir l’histoire telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à nos jours.
Dans l’histoire des relations internationales, il y a toujours eu quelques principes qui s’appliquent d’une manière générale. Un d’entre eux est la maxime de Thucydides, qui dit que les forts agissent comme ils l’entendent alors que les faibles sont condamnés à subir. Un corollaire à cela est ce qu’Ian Brownie appelle « l’approche hégémonique du droit » : c’est la volonté des puissants qui détermine la jurisprudence.
Un autre principe vient de l’analyse d’Adam Smith sur le fonctionnement de la politique en Angleterre : les « principaux architectes » de la politique - à son époque il s’agissait des « commerçants et industriels » - font en sorte de voir leurs propres intérêts « particulièrement bien défendus » quels qu’en soient les « effets négatifs » sur les autres, y compris le peuple anglais – mais plus encore sur les populations soumises à la « justice sauvage des Européens » - notamment celle de l’Inde colonisée à laquelle Adam Smith pensait en priorité.
Un troisième principe est celui-ci : en matière de politique internationale, pratiquement tous les recours à la force ont été justifiés par la « responsabilité de protéger », y compris par les pires monstres.
Afin d’illustrer mon propos, prenons Sean Murphy qui, dans son étude universitaire « l’intervention humanitaire », cite trois exemples entre le pacte Kellogg Briand et la Charte des Nations Unies : l’attaque du Japon sur la Mandchourie, l’invasion de l’Ethiopie par Mussolini, l’occupation d’une portion de la Tchécoslovaquie par Hitler. Toutes ont été accompagnées par de pompeux discours sur le devoir sacré de protéger des populations opprimées et d’autres justifications du même genre. Ce principe s’applique encore de nos jours.
Lorsqu’on entend « la responsabilité de protéger », ou son cousin, décrits comme la « norme émergeante » en matière de relations internationales, il convient de faire un rappel historique. On constate alors qu’elles ont toujours été la norme, aussi loin que l’on remonte en arrière. La fondation de ce pays (les Etats-Unis – NdT) en est un exemple. En 1629, la Colonie de Massachusetts Bay s’est vue accorder sa Charte par le Roi qui a déclaré que « la principale raison d’être de cette colonie » était de sauver les indigènes de leur triste destin de païens. Le Grand Sceau de la Colonie représente un Indien qui dit « Venez nous aider ». Les colonisateurs anglais, lorsqu’ils se sont lancés, selon leurs propres termes, dans « l’extirpation » et « l’extermination » des indigènes – et pour leur propre bien, comme l’ont expliqué leurs honorables successeurs - accomplissaient donc un devoir de protection. En 1630, John Winthrop a prononcé un célèbre sermon qui décrivait la nouvelle nation « ordonnée par Dieu » comme une « cité sur la colline », une rhétorique d’illuminé qui est constamment employée pour justifier les pires « écarts » de cette noble mission de la R2P.
Il serait facile de donner d’autres exemples avec d’autres empires au sommet de leur puissance. On comprend dés lors que les puissants préfèrent oublier l’histoire et regarder vers l’avenir. Mais les faibles auraient tort de les suivre.
Il y a 60 ans, le cadavre est sorti du placard lors du premier procès de la Cour Internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire du détroit de Corfou.
Selon le jugement, « La Cour ne peut admettre un tel système de défense. Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par elle que comme la manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international. L’intervention est peut-être moins acceptable encore dans la forme particulière qu’elle présenterait ici, puisque, réservée par la nature des choses aux États les plus puissants, elle pourrait aisément conduire à fausser l’administration de la justice internationale elle-même. » (traduction officielle de l’arrêté de la CIJ, avril 1949 – NdT)
C’est dans ce même esprit que s’est tenu en avril 2000 le premier sommet des pays du Sud, auquel ont participé 133 états. Sa déclaration, qui avait très certainement en mémoire le récent bombardement de la Serbie, a rejeté le « soi-disant « droit » d’intervention humanitaire qui n’a aucun fondement juridique que ce soit dans la Charte des Nations Unies ou dans les principes généraux du Droit International. » Les termes de la déclaration confirment celles de l’importante Déclaration sur les Relations d’Amitié des Nations Unies (UNGA, Res 2625, 1970). Ces termes ont été confirmés depuis par la réunion des ministres du Mouvement des Pays Non-alignés en Malaisie en 2006, entre autres, qui une fois encore représentait les victimes habituelles de ces interventions en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans le monde arabe.
La même conclusion a été tirée en 2004 par un haut comité des Nations Unies sur les Menaces, les Défis et le Changement. Le Comité a rejoint les positions de la Cour Internationale de Justice et le Mouvement des Non-alignés en concluant que « l’article 51 ne nécessite ni extension ni limitation de son domaine d’application qui a toujours été clair pour tous. » Le Comité a ajouté que « pour ceux qui seraient insatisfaits par cette réponse, il convient de rappeler que dans un monde rempli de menaces potentielles, le risque posé à l’ordre international et la norme du non-interventionnisme sur lequel il repose est tout simplement trop grand pour accepter une action préventive unilatérale, qui se distingue d’une action décidée collectivement. L’accepter pour un reviendrait à l’accepter pour tous » - ce qui, bien sûr, est impensable.
Et le même principe fut adopté par le Sommet Mondial de l’ONU en 2005.
Tout en réaffirmant des positions qui avaient déjà été entérinées, le Sommet a aussi confirmé la volonté « d’entreprendre des actions collectives, à travers le Conseil de Sécurité et en accord avec la Charte… si les moyens pacifiques se révèlent inadaptés et les autorités nationales manifestement incapables de protéger les populations » de crimes commis à leur encontre. Au pire, la phrase précise la formulation de l’article 42 sur l’autorisation du Conseil de Sécurité de recourir à la force.
Et c’est ainsi que le cadavre est maintenu enfermé dans le placard et la question taboue évitée - dans l’hypothèse, et c’est une grosse hypothèse, où le Conseil de Sécurité serait un arbitre impartial, insensible aux maximes de Thucydides ou d’Adam Smith - mais j’y reviendrai.
Il y a bien eu quelques efforts, aussi louables soient-ils, pour distinguer la « responsabilité de protéger » de l’intervention humanitaire, mais rien dans les faits ne le démontre. Ce n’est pas pour rien que « le droit à l’intervention humanitaire » a été fermement critiqué et qu’il a provoqué un schisme principalement entre les pays du Nord et ceux du Sud, alors même que la « responsabilité de protéger » avait été adoptée – ou re-confirmée pour être plus précis – par consensus lors du Sommet : tout simplement parce que l’acceptation par le sommet de la terminologie sur la « responsabilité de protéger » ne change pas grand-chose sur le fond.
Les droits énoncés dans les paragraphes cruciaux 138 et 139 de la déclaration n’ont pas été sérieusement remis en cause. En fait, ils ont même été confirmés et appliqués, par exemple, dans le cas de l’apartheid en Afrique du Sud. De plus, le Conseil de Sécurité avait déjà prévu dans le Chapitre VII qu’il pouvait recourir à la force pour faire cesser des violations massives de droits de l’homme, les guerres civiles et les violations de droits civiques : résolutions 925, 929, 940, juin-juillet 1994.
Comme le remarque J. L. Holzgrefe, « la plupart des états sont déjà signataires de conventions qui les obligent par la loi à respecter les droits de l’homme de leurs citoyens. » Les rares succès à mettre au crédit de la R2P , comme au Kenya, n’avaient pas besoin de la résolution du Sommet, même si la terminologie de la R2P fut employée à cette occasion. Concrètement, la R2P, telle qu’elle est formulée par le Sommet, n’est qu’un sous-ensemble du « droit d’intervention humanitaire », sauf pour la partie contestée, c’est-à-dire le droit de recourir à la force sans l’autorisation du Conseil de Sécurité.
Ceci ne signifie pas que l’accent mis sur les droits, qui sont déjà largement admis, soit insignifiant. Mais sa véritable signification est déterminée par sa mise en application sur le terrain. Et sur ce plan là, il n’y pas de quoi se réjouir.
Les restrictions définies par l’affaire du Détroit de Corfou et celles qui ont suivi ont parfois été ignorées. L’acte constitutif de l’Union Africaine déclare « le droit de l’Union d’intervenir dans un état membre … en cas de circonstances graves . » Ce qui diffère nettement de la Charte de l’Organisation des Etats d’Amérique (O.E.A.), qui interdit toute intervention « pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre état. » La raison d’une telle différence est évidente. La Charte de l’O.E.A. a pour objectif d’empêcher toute intervention de la part du « voisin géant du Nord » - ce en quoi elle a échoué, bien sûr. Mais après la chute des états de l’apartheid, l’Union Africaine n’était pas confrontée à ce genre de problème.
Si la doctrine de l’Union Africaine devait être appliquée à l’O.E.A. ou à l’OTAN, ces dernières seraient en droit d’intervenir au sein même de leur alliance. Une idée qui nous mènerait à des conclusions intéressantes et révélatrices sur l’O.E.A. et l’OTAN qu’il est inutile de développer ici. De toute façon, ces conclusions resteraient lettre morte, comme il l’a été démontré dans un passé récent, grâce à la maxime de Thucydides.
Je ne connais qu’une seule proposition faite à un haut niveau pour étendre la R2P au-delà du consensus du Sommet et de l’extension de l’Union Africaine, c’est celle du Rapport du Commission Internationale sur l’Intervention et la Souveraineté des Etats sur la R2P (2001). Dans ce rapport, la Commission envisage une situation dans laquelle « le Conseil de Sécurité rejetterait une proposition ou s’abstiendrait d’intervenir dans un délai raisonnable. » Dans ce cas, le Rapport autorise « une action dans le cadre de la juridiction des organisation régionales ou sous-régionales sous le Chapitre VIII de la Charte, sous condition d’obtenir l’autorisation du Conseil de Sécurité » ((3), E, II).
A ce stade, la présence du cadavre dans le placard commence à se faire sentir. Une des raisons à cela est que les puissants décident seuls de leur « zone de juridiction ». L’O.E.A. et l’U.A. ne peuvent pas le faire mais l’OTAN le peut et ne s’en prive pas. L’OTAN a décidé de manière unilatérale que les Balkans faisaient partie de « sa zone de juridiction » - mais pas l’OTAN elle-même, où de graves crimes ont été commis contre les Kurdes dans le sud-est de la Turquie dans les années 90. Certains états sont donc concernés et d’autres pas, selon le soutien militaire et diplomatique qu’ils reçoivent de l’administration US et d’autres états membres de l’OTAN.
L’OTAN a décidé aussi que sa « zone de juridiction » s’étendait jusqu’en Afghanistan et au-delà. Le Secrétaire général Jaap de Hoop Scheffer a déclaré lors d’une réunion de l’OTAN au mois de juin 2007 que « les troupes de l’OTAN doivent protéger les oléoducs et gazoducs destinés à l’Occident » et d’une manière plus générale protéger les voies maritimes empruntées par les pétroliers et autres « infrastructures cruciales » du réseau énergétique. Les droits étendus accordés par la Commission Internationale sont, dans la pratique, exclusivement réservés à l’OTAN, ce qui constitue une violation des principes énoncés dans l’affaire du détroit de Corfou et confirmés depuis, et ouvre la voie à une justification par la R2P de toute intervention impériale qu’elle déciderait d’entreprendre.
Le principe du détroit de Corfou permet de mieux comprendre à la fois l’enchaînement des événements et les invocations rhétoriques relatives à la R2P et à l’intervention humanitaire, ainsi que leur application sélective sous couvert de cette nouvelle incantation. La « révolution normative » annoncée par les commentateurs occidentaux a commencé dans les années 90, au lendemain de la chute de l’Union Soviétique qui avait servi jusqu’à là de prétexte systématique à toutes les interventions.
L’administration Bush (père) avait réagi à la chute du Mur de Berlin en annonçant officiellement la nouvelle politique de Washington : en en mot comme en cent, tout allait être comme avant, mais avec de nouveaux prétextes. Nous avons toujours besoin d’un énorme appareil militaire, mais pour une nouvelle raison : « la sophistication technologique » des puissances du tiers monde. Nous devons préserver « notre industrie militaire de base » - un euphémisme qui désigne une industrie high-tech soutenue par l’état. Nous devons maintenir des forces d’intervention dirigées vers les régions pétrolifères du Moyen-Orient – là où les menaces qui exigeaient nos interventions militaires ne sont plus représentées par « le Kremlin », contrairement aux prétextes avancés depuis des décennies. De nouveaux prétextes étaient donc nécessaires, et la « révolution normative » est entrée en scène, une fois de plus.
Cette interprétation des événements est confirmée par la manière sélective avec laquelle la R2P est appliquée. Il n’était évidemment pas question d’appliquer ce principe dans le cas des sanctions imposées par le Conseil de Sécurité à l’Irak, sanctions qualifiées de « génocidaires » par deux anciens directeurs du programme « nourriture contre pétrole », Denis Halliday et Hans von Sponeck, qui ont tous deux démissionné en guise de protestation. L’étude détaillée de von Sponeck sur les terribles effets de ces sanctions a été virtuellement censurée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, qui sont les principaux auteurs du programme de sanctions.
De même, il n’est nullement envisagé de l’invoquer pour protéger la population de Gaza, autre responsabilité des Nations Unies, avec toutes les autres « populations protégées » (par les Conventions de Genève), à qui on nie les droits humains fondamentaux. Rien de sérieux n’est envisagé non plus pour la pire catastrophe en Afrique, sinon du monde : le Congo oriental où, il a seulement quelques jours encore, et selon la BBC, les sociétés multinationales étaient accusées encore une fois de violer une résolution des Nations Unies contre le trafic illicite des précieux minerais et de financer ainsi le conflit meurtrier.
Dans un tout autre domaine, il n’est même pas envisagé d’invoquer ne serait-ce que les mesures les plus anodines prévues par la R2P pour répondre à la faim dans les pays pauvres.
L’ONU a récemment estimé que le nombre de personnes qui souffrent de faim a dépassé le milliard, alors que le Programme Alimentaire de l’ONU vient d’annoncer de fortes restrictions budgétaires parce que les pays riches sont en train de réduire leurs maigres contributions pour se consacrer au sauvetage des banques.
Il y a quelques années, l’UNICEF avait annoncé que 16.000 enfants mourraient chaque jour de faim ou de maladies facilement curables. Ce chiffre a augmenté depuis. Rien que dans le sud de l’Afrique, l’hécatombe se déroule au même rythme que le génocide du Rwanda, sauf qu’il ne se déroule pas sur une période de 100 jours, mais se répète tous les jours. Ces données sont connues et pourtant aucune initiative n’est prévue au nom de la R2P, ce qui serait assez facile à faire avec un peu de volonté.
Dans tous ces exemples et dans de nombreux autres cas, la sélectivité s’applique avec une cruelle précision selon la maxime de Thucydides, et confirment les craintes exprimées par la Cour Internationale de Justice, il y a 60 ans.
L’exemple le plus frappant de cette sélectivité extrême et systématique pourrait être l’année 1999, lorsque l’OTAN a bombardé les Serbes, une attaque présentée en Occident comme le joyau de la couronne de la « norme émergente » de l’intervention humanitaire, à l’époque où les Etats-Unis étaient « au sommet de leur puissance » à la tête des « pays civilisés », lorsque « le Nouveau Monde idéaliste, décidé à mettre fin à l’inhumanité » avait ouvert une nouvelle ère en agissant selon « des principes et des valeurs », pour ne citer que quelques uns des propos tenus à l’époque par les intellectuels occidentaux.
Cet autoportrait flatteur se ternit sous l’examen. D’abord parce que les victimes habituelles des interventions occidentales ont vigoureusement protesté. J’ai déjà cité la position du Mouvement des Pays Non-alignés ; Nelson Mandela fut particulièrement sévère dans sa condamnation. Mais ça n’a posé aucun problème, parce que l’opinion des gueux peut être facilement ignorée.
De plus, le bombardement a ouvertement violé la Charte des Nations Unies, encore un problème dont ils se sont facilement débarrassé. Certains se sont livrés à des contorsions juridiques, mais comme l’a formulé la Commission Goldstone, le bombardement était « illégal mais légitime », une conclusion à laquelle ils sont parvenus en inversant la chronologie des bombardements et des atrocités.
Ce qui nous amène à un troisième problème : les faits. Les faits sont parfaitement documentés, et par des sources occidentales fiables. Et ce que les faits révèlent est incontestable. Le bombardement de l’OTAN n’a pas mis fin aux atrocités mais a plutôt provoqué les pires d’entre elles, comme cela avait été prévu par le commandement de l’OTAN et la Maison Blanche. Les conclusions qui sont si bien documentées par les archives occidentales sont confirmées lorsque l’on constate que l’inculpation de Milosevic fut prononcée par le Tribunal Pénal International en pleine campagne de bombardements.
A une exception prés, toutes les accusations portées contre Milosevic concernaient la période qui a suivi le déclenchement des bombardements. Et nous pouvons affirmer que la seule accusation relative à la période précédent les bombardements – à savoir le massacre de Racak – n’avait en réalité aucune importance aux yeux des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, ne serait-ce que parce qu’à la même époque ils étaient eux-mêmes en train de soutenir activement des crimes bien pires commis au Timor Oriental, où les atrocités étaient sans commune mesure avec celles commises dans les Balkans.
Là aussi, le problème fut réglé assez facilement : par la censure.
Le cas du Timor Oriental est particulièrement instructif. J’ai personnellement témoigné devant le 4ème Comité en 1978, lorsque les atrocités avaient atteint un niveau « d’extermination assimilable à un crime contre l’humanité commis contre la population du Timor Oriental, » selon les propos de la future Commission Vérité parrainée par les Nations Unies. Dans leur soutien aux atrocités, les Etats-Unis ont été rejoints par la Grande-Bretagne et la France, puis par l’Australie et d’autres pays, et ils ont continué en 1999, lorsque les atrocités ont repris de plus belle. Après le paroxysme final du terrorisme d’état de Septembre 1999, qui a détruit la majeure partie de ce qui restait du pays, le Conseiller à la Sécurité Nationale, Sandy Berger, a déclaré que les Etats-Unis allaient continuer d’apporter leur soutien aux agresseurs, en expliquant que « je ne pense pas que quelqu’un ait jamais énoncé une doctrine qui stipule que nous devons intervenir partout où se pose un problème humanitaire. » Entre-temps, la R2P avait disparu, comme d’habitude.
Dans ce cas précis, pour mettre une fin aux atrocités, il n’y avait nulle besoin de bombardements, de sanctions, ou de quoi que ce soit sinon de la décision de ne plus y participer. Chose qui fut démontrée peu de temps après la déclaration de Berger sur la politique occidentale lorsque, suite à de fortes pressions internes ainsi que de l’étranger, Clinton a formellement mis fin à la participation des Etats-Unis. Les envahisseurs se sont immédiatement retirés et la force de maintien de la paix des Nations Unies a pu entrer sans difficulté. Les Etats-Unis auraient pu se retirer à n’importe quel moment au cours des 25 années qui ont précédé. De façon incroyable, cette histoire horrible a été rapidement présentée comme un succès à mettre au compte de la R2P. Une telle distorsion des faits est si scandaleuse que les mots me manquent pour la qualifier.
J’ai déjà dit que le consensus du Sommet Mondial ne respectait le principe de Corfou et ses suites qu’à condition de présumer que le Conseil de Sécurité est neutre. A l’évidence, ce n’est pas le cas. Le Conseil de Sécurité est contrôlé par ses cinq membres permanents, et tous ne sont pas égaux en termes d’interventions. Une idée nous en est fournie par l’examen de l’exercice du droit de veto qui est la manière la plus radicale de violer une résolution du Conseil de Sécurité. La période significative démarre au milieu des années 60, lorsque la décolonisation et la reconstruction de l’après-guerre ont donné à l’ONU ne serait-ce qu’un semblant de représentativité de l’opinion mondiale. Depuis cette époque, les Etats-Unis détiennent le record absolu, la Grande-Bretagne arrive en deuxième position et tous les autres suivent loin derrière. Au cours des 25 dernières années, la Chine et la France ont opposé leur veto à trois reprises, la Russie quatre, la Grande-Bretagne dix, et les Etats-Unis 43, y compris contre des appels au respect du Droit International. Le cadavre dans le placard pousse un soupir de soulagement tandis que la maxime de Thucydides s’impose une fois de plus.
Une manière de corriger ce défaut dans le consensus du Sommet Mondial serait d’abolir ce droit de veto, ce qui, soi dit en passant, correspondrait à la volonté de la majorité des Américains qui pensent que les Etats-Unis devraient respecter la volonté de la majorité et que ce sont les Nations Unies, et non les Etats-Unis, qui devraient se charger de régler les crises internationales. Et c’est là que nous nous heurtons à la maxime d’Adam Smith, qui rend de telles hérésies impensables, et nous interdit ne serait-ce que d’imaginer une application de la R2P à ceux qui en ont désespérément besoin mais qui ont le malheur de ne pas plaire aux puissants.
Ce qui soulève une autre question. Les maximes qui s’imposent dans les affaires internationales ne sont pas immuables et, en fait, s’appliquent même avec moins de rigueur depuis quelques années grâce aux effets civilisateurs des mouvements populaires. Pour ce projet à long terme et essentiel, la R2P peut se révéler un outil précieux, à l’instar de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).
Même si les états n’adhèrent pas à la DUDH, et certains même, comme les Etats-Unis, vont jusqu’à en rejeter une bonne partie, il sert néanmoins de référence aux militants dans leurs activités d’organisation et d’éducation, souvent avec efficacité.
Mon sentiment est que si un grand débat s’instaurait, avec un minimum de participation, à laquelle malheureusement les puissants ne semblent pas prêts, la R2P pourrait jouer un rôle similaire et avoir un effet tout à fait significatif.
Noam Chomsky
Juillet 2009
http://www0.un.org/ga/president/63/...
Traduction VD pour le Grand Soir