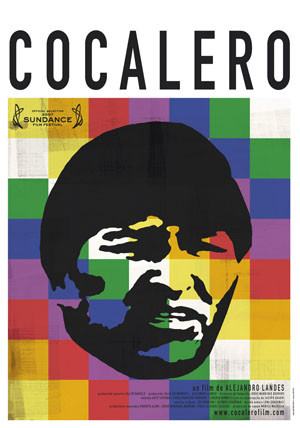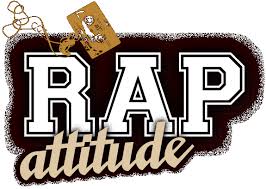Jean-Baptiste de Foucauld, « Gorz et le temps choisi, un débat inachevé », Revue du MAUSS permanente, 10 mars 2009 [en ligne]. http://www.journaldumauss.net/spip.php?article481
En 1980, dans ses Adieux au prolétariat, André Gorz rompait avec la vision eschatologique du marxisme selon laquelle la classe ouvrière, se réappropriant le travail, se libérait dans et par le travail. Le travail hétéronome et donc dépendant devenant une fatalité incontournable, il plaidait pour une société dualiste ouvrant des espaces d’autonomie et assurant progressivement la libération non plus « par » le travail, mais « du » travail lui-même, celui-ci devenant œuvre, activité, épanouissement de soi et des relations aux autres dans une société à la fois égalitaire et plurielle. C’est le sillon qu’il n’a cessé de creuser dans les livres qui ont suivi.
La même année, avec Echange et Projets, nous achevions la publication de la « Révolution du Temps choisi », livre préfacé par le Président du club, Jacques Delors. Nous plaidions – et continuons encore aujourd’hui de plaider – pour le droit absolu des salariés à maîtriser leur temps de travail et d’arbitrer entre temps de travail et niveau de revenu, dans une perspective de vie individuelle et collective différente, plus équilibrée, plus créative, plus solidaire. L’ouvrage eût du mal à percer, face à la chape de plomb des 35 heures qui emprisonnait déjà la gauche. Mais il intéressa André Gorz qui a bien voulu s’y réfèrer à plusieurs reprises, notamment dans l’ouvrage qui, en 1988, prend la suite des Adieux du prolétariat : Métamorphoses du travail, quête de sens. Dans une note en bas de la page 147, tout d’abord, il y voit « l’un des très rares ouvrages à avoir montré la rupture avec le modèle de développement capitaliste qu’impliquerait le droit à autodéterminer la durée du travail ». Il y revient dans la 3ème partie, « Orientations et propositions » (pages 223 et 224), approuve le souci des auteurs de réduire le travail au rang de moyen, d’inventer un art de vivre, et de susciter des formes renouvelées de créativité sociale réduisant la place des valeurs d’efficacité et de rentabilité liées au travail. Citant le passage de notre livre sur les « activités humaines engendrées par le temps libre » contribuant au ré enchantement du monde et à des dynamiques sociales ouvrant la voie aux belles notions d’activité et d’œuvre, il voit une convergence avec le programme du SPD [1] de 1986 qui met l’accent sur le développement d’une culture « centrée sur des activités autodéterminées qui empêche l’exploitation des gens » et qui permet de « développer chez les individus des capacités et des penchants que le travail rémunéré fait dépérir ou pour le moins ne sollicite pas ».
Cependant, si la convergence sur l’objectif antiproductiviste est réelle, il n’y a pas vraiment accord sur les moyens. Sans exclure, loin de là, une réduction générale de la durée du travail, Echange et Projets développait principalement une vision libertaire et individualiste d’un nouveau droit personnel à mettre en place, faisant une (trop ?) large confiance au jeu des préférences individuelles et à l’émergence d’une plus grande rationalité en terme d’équilibre de vie et de consommation élargie. André Gorz, lui, adopte d’emblée, prioritairement, frontalement même, une approche collective. Il a une réponse « de principe » : « la réduction programmée, par paliers, sans perte de revenus réels, de la durée du travail, en conjonction avec un ensemble de politiques d’accompagnement qui permettent à ce temps libéré de devenir pour tous celui du libre épanouissement » (p. 223).
Un second désaccord apparaît : là où les auteurs de la Révolution du temps choisi lient étroitement partage du travail et partage des revenus, tant dans l’approche individuelle que dans l’approche collective, Gorz l’exclut, en tout cas pour le processus collectif qui est pour lui le plus important.
Ce double désaccord, se fit sentir fortement, lors du débat passionnant qu’Arte organisera en 1994 dans la maison « très ancienne, fraîche en été, chaude en hiver », où il s’était retiré avec Dorine [2]. Son discours s’était radicalisé en ce sens qu’il cheminait déjà vers une allocation universelle inconditionnelle, un droit au revenu indépendant du travail, ou un droit général à l’intermittence, thème auquel il se ralliera clairement en 1997 dans Misères du présent, richesse du possible . Dans ce livre, il explique que le tournant du postfordisme a été manqué : les germes d’autonomie qu’il contenait, qui n’ont pu être expérimentés que trop rarement (dans les usines Volvo par exemple) n’ont pas été saisis. Bien au contraire, c’est une régression que l’on observe, car la domination du capital prend désormais la forme perverse d’un « conditionnement qui conduit le sujet à accepter ou choisir cela précisément qu’on entend lui imposer ». Mais d’une certaine façon, peu importe, car « la société du travail est morte » et « il n’y a pas et il n’y aura plus jamais de travail ». Car « le salariat doit disparaître et le capitalisme avec lui ».
Dès lors, le but, c’est la société de multi-activité où « tous attendent de tous qu’ils cumulent une pluralité d’activité ou de mode d’appartenances », où le but n’est pas « de sélectionner, d’éliminer, de hiérarchiser, mais d’encourager chaque membre à se renouveler et à se surpasser perpétuellement dans la coopération compétitive avec les autres ». Une société où le travail a perdu sa centralité, où l’activité que l’on exerce importe plus que l’emploi que l’on a eu que l’on n’a pas. En un mot, une société au sein de laquelle « chacun puisse faire au travail sa place au lieu que la vie ait à se contenter de la place que lui laissent les contraintes de travail ». C’est une rupture, une société autre. Car un revenu suffisant est garanti à tous. Gorz abandonne le principe d’un revenu garanti lié à l’exercice d’un certain volume de travail tout au long de la vie. Refusant les formules de workfare, il se rallie au droit de vivre sans travailler et opte donc pour une forte inconditionnalité afin de laisser libre cours à ce qu’il appelle les « activités vivantes », où l’homme est pleinement lui-même. Celles-ci, à terme, ont atteint un tel niveau d’activité que la question du revenu minimum ne se pose plus dans les termes de redistribution fiscale qui le rendent peu soluble ou crédible. Il se fonde en effet sur les échanges non monétaires, sur l’autoproduction, sur les services collectifs.
Les auteurs de la Révolution du temps choisi, tout en gardant eux aussi intact, à leur manière, le droit à l’utopie, n’avaient pas évolué dans la direction hyper politique de Gorz. Voyant l’échec du temps choisi, soucieux, comme lui d’ailleurs, de formes nouvelles de solidarité incluant les chômeurs, ils s’étaient lancés dans l’expérience citoyenne de Solidarités nouvelles face au chômage (SNC), expérience fondée sur le partage de temps et de revenu entre non-chômeurs et chômeurs afin d’accompagner ceux-ci vers l’emploi et, si besoin, de créer des emplois à leur intention grâce aux contributions monétaires des participants [3]. Au fond, c’est le même problème, mais pris par l’autre bout, de manière plus exigeante : le temps choisi permet à des personnes de s’extraire du travail productif rémunéré pour développer des activités libres, cela en abandonnant une partie de leur revenu, ce qui, parallèlement, redistribue l’emploi au profit des chômeurs. Dans le cadre de SNC, des personnes organisées et coopérant entre elles ne réduisent plus leur temps de travail, mais utilisent leur temps libre pour aider des chercheurs d’emploi et partagent une partie de leur revenu, le cas échéant, pour subventionner et créer des emplois pour ces personnes si elles en ont besoin. Dans les deux cas, on constate une approche de partage de temps et de revenu, bien que sous des modalités différentes. Dans les deux cas, l’Etat n’intervient pas, et l’initiative vient tantôt des individus isolés (temps choisi), tantôt de personnes regroupées dans une organisation de société civile (SNC). On se situe ici, et c’est la grande différence avec Gorz, dans une perspective non dualiste : il y a continuum entre la société du travail et la société des activités libres et il n’y a pas besoin de l’intervention de l’Etat. L’approche de Gorz est plus dualiste, plus étatique, plus efficace … à condition de pouvoir être menée à bien.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? C’est être, sans aucun doute, fidèle à l’œuvre d’André Gorz que d’évaluer de manière critique ce qui s’est passé, afin d’en tirer des leçons utiles pour l’avenir, dans une période de grands bouleversements. Car, au fond, ni la voie « Gorzienne », ni la voie du temps choisi n’ont été empruntées par notre pays [4]. Les 35 heures ont été décrétées sans partage des revenus, puis réalisées de fait, comme on pouvait s’y attendre, avec des techniques de partage des revenus, l’Etat étant fortement mis à contribution. Cela n’a que partiellement marché, et encore, à un coût élevé. Quelles leçons en tirer, que faut-il faire aujourd’hui, comment utiliser de manière féconde l’énorme travail de réflexion de Gorz ?
Les trois legs incontournables d’André Gorz
a) L’autolimitation et la maîtrise du désir. Gorz se bat inlassablement contre le superflu, l’alimentation permanente des désirs par le système productif et il veut revenir aux besoins fondamentaux. Cela est particulièrement net dans Capitalisme, Socialisme, Ecologie [5]. On y lit notamment (p. 170) : « Si nous pouvions ajuster notre temps de travail aux besoins que nous ressentons réellement, combien d’heures travaillerions-nous ? ». Et plus loin (p. 171) : « La politique du temps est le meilleur levier pour obtenir en même temps la réduction, écologiquement nécessaire, de la consommation de marchandises et la plus grande autonomie possible pour chacun et chacune dans la conduite de la propre vie ».
Cette question de l’autolimitation est devenue d’autant plus nécessaire que l’écart entre les désirs, stimulés de toute part, et les moyens, qui s’accroissent moins vite qu’avant, est devenu béant. Les possibilités d’augmenter plus rapidement la production sont limitées dans l’économie tertiaire, confrontée au ralentissement de la productivité globale du travail, au vieillissement démographique, à la concurrence des pays neufs et aux tâches de réparation écologique. Il va falloir ramener les désirs vers l’essentiel, cela de manière démocratique et acceptable. Avec là, 2% de surplus à distribuer chaque année, les marges de manœuvre sont faibles. Il va falloir changer de style de vie pour préserver notre niveau de vie. Nous n’y sommes pas prêts, pour n’avoir pas écouté les voies prophétiques comme celle de Gorz.
b) La maîtrise par chacun de son temps de travail rémunéré est un moyen de parvenir à cette sagesse collective. Le temps choisi est une ressource citoyenne de contre-pouvoir, qui permet à chacun de travailler moins (et de gagner moins) ou de travailler plus (et de gagner plus) en fonction de ses besoins, de ceux de ses proches, de son style de vie. C’est aussi un moyen de mettre en mouvement les « activités vivantes ». L’échec des 35 heures, ou ce qui est ressenti comme tel, ne doit pas entraîner la fermeture définitive du dossier du droit à la maîtrise du temps. Il doit être ré-ouvert, sur des bases nouvelles, mais il est plus fondamental que jamais. Le temps est un bien économique qui doit pouvoir être maîtrisé par chacun. La possibilité de dégager du temps libre pour faire autre chose que travailler est aussi un moyen de produire des satisfactions à un moment où les satisfactions provenant de l’activité productive sont difficiles à augmenter. C’est un moyen de reconvertir les désirs, de les orienter vers l’essentiel aux dépens du superflu.
c) L’objectif de modérer les désirs, d’ouvrir la voie du temps choisi, de favoriser la sobriété, pose avec encore plus d’acuité la question de la justice et de la redistribution. La croissance forte des années soixante solutionnait indirectement la question de la justice. Chacun pouvait espérer, peu à peu, obtenir ces biens nouveaux offerts par le développement. Dans un contexte de développement sobre et modéré, on ne peut plus compter sur cette fuite en avant. La question sociale devient plus compliquée, à laquelle Gorz n’a cessé de s’atteler. Elle doit être traitée en profondeur. La redistribution, sous ses différentes formes, est aussi importante que la production, qu’il ne s’agit pas non plus de négliger. L’une et l’autre sont d’ailleurs intimement liées. La sobriété, pour être acceptée, ne peut être que créative et solidaire. Créative parce qu’elle ne s’oppose pas au développement tout en ayant pour objet de l’orienter différemment en faisant appel à l’imagination, à la recherche, à la « coopération compétitive ». Solidaire, parce que la réduction du superflu chez les uns est de plus en plus la condition pour que chacun soit en mesure d’accéder à ce qui est jugé à un moment donné comme socialement essentiel.
Que revisiter chez Gorz ?
Il y a, selon nous, débat sur les moyens d’aboutir aux résultats visés, qui tient largement aux présupposés idéologiques, économiques et sociologiques de l’auteur.
Le marxisme tout d’abord : s’il fournit une clef de lecture importante, bien que partielle, de toute société, son rapport aux moyens n’est pas clair. Or, il faut se demander si Gorz ne reste pas prisonnier, plus qu’il ne le croit lui-même, de la dialectique hégéliano- marxiste, qui résorbe le conflit dans l’unité ; certes, on peut dire qu’il ait inversé cette dialectique : il garde le conflit, mais il le fige et le bétonne : il y a le monde de l’hétéronomie, c’est une fatalité, et il y a le monde de l’autonomie, c’est la liberté. Il faut prélever sur l’un pour alimenter l’autre, c’est le revenu d’existence qui assure le transfert. Gorz abandonne, à juste titre, le monisme marxiste, mais il tombe dans l’excès inverse d’un dualisme abrupt et sans porosité. Il s’appuie sur un dualisme de séparation, non sur un dualisme de complémentarité, dualisme qui laisserait ouverte la possibilité d’une unité n’abolissant pas les termes antagonistes. On voit bien que le choix n’est pas entre le conflit sans solution, ou une solution qui abolit le conflit, mais dans la gestion démocratique permanente de l’antagonisme. Revenons à Héraclite : « Tout arrive par discorde et par nécessité » ! Entre le monde de l’hétéronomie et celui de l’autonomie, les liens sont inévitables et mieux vaut s’efforcer de les tisser que de les nier ou d’y voir une domination inévitable du premier sur le second.
L’analyse économique ensuite, d’ailleurs assez (trop ?) dépendante de l’idéologique. Pour Gorz il n’y aura plus jamais assez de travail pour tout le monde et les gains de productivité permettent de libérer du temps. Ce n’est pas si simple. Le rythme de progression de la productivité a été divisé par deux ou trois par rapport aux années 1960. Le financement des retraites et de l’Etat providence implique une base productive étendue, ce qui rend très aléatoire la possibilité d’assurer à chacun, de la naissance à la mort, un revenu d’existence inconditionnel. L’idée que le nombre d’heures travaillées diminue et que l’emploi se contracte inéluctablement est inexacte, même si la part du travail dans la vie diminue en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Il n’y a donc aucune raison de se résigner au chômage ou au travail intermittent. Il faut au contraire s’organiser pour revenir au plein emploi, à un plein emploi de qualité à temps choisi, pour des activités qui aient du sens, avec une protection sociale correcte, dans un environnement protégé, en multipliant, diversifiant, qualifiant et sécurisant les parcours professionnels : c’est dans un tel contexte que les activités dites autonomes le seront vraiment, car choisies, non dépendantes, non assistées. Il est clair que cela implique de solides disciplines collectives qui ne peuvent être éludées. Les formules du type revenu d’existence inconditionnel, qui peuvent flatter les mauvais penchants de l’individualisme autarcique et autoréférencé ambiant, risquent d’en détourner.
L’analyse sociologique enfin : Gorz sous estime le rôle identitaire du travail hétéronome, quels que soient ses défauts. Si les femmes ont massivement cherché à accéder au travail hétéronome, alors que, après tout, le modèle traditionnel de femme au foyer leur donne d’assez grandes possibilités d’activités qui n’ont pas besoin d’être rémunérées, c’est bien sûr parce que ces activités sont dépendantes du revenu du conjoint et parce qu’elles veulent être vraiment autonomes, c’est à dire autonomes par elles-mêmes. Mais cette autonomie passe précisément par l’intégration dans la division du travail hétéronome. Il y a donc bien complémentarité entre les deux mondes. Et d’ailleurs, comment nier que les compétences acquises dans le travail hétéronome alimentent ensuite le développement des activités autonomes ? Et réciproquement. La capacité à se rendre utile à autrui en s’intégrant dans la division du travail est, elle aussi, un mode de formation de la personne et du développement de la société. Le problème est que cette capacité ne monopolise ni le champ personnel, ni le champ social, contrairement à la situation actuelle. Mais, dans cette perspective, on cherche plus à rééquilibrer, à compenser, à faire contrepoids, à réorienter, non à séparer et à cloisonner les deux mondes du travail hétéronome et de l’activité autonome.
Comment poursuivre ?
D’abord retrouver le sens de l’utopie. C’est ce à quoi Gorz nous invite en permanence. Mais il faut tenir compte de l’expérience historique et répudier la forme globale, frontale de l’utopie, caractérisée par un Avant et un Après. La culture de l’utopie a sa place, mais comme tension, processus, visée, ensemble de pratiques. Elle repose non sur la contrainte, mais sur l’éducation, la force de conviction, l’exemplarité, la valorisation des valeurs. Elle doit être régulée démocratiquement. Elle doit se concilier avec les cultures complémentaires, mais différentes, de résistance et de régulation, ce qui ne va pas de soi. Elle est plus locale, ou plus transversale que globale [6].
Ensuite remettre sur le métier le dossier du temps choisi, entendu comme droit fondamental devant s’imposer à la société économique. Il faut aller au-delà de l’optimisme du livre de 1980 et mieux mesurer les obstacles à franchir : le conditionnement des esprits, les problèmes d’organisation, le risque de précarité ou de pénalité de carrière, les besoins criants de pouvoir d’achat. C’est un changement complet d’état d’esprit à provoquer, un changement culturel, un élément essentiel de la démocratie économique, une révolution démocratique destinée à rendre moins imparfaite la démocratie et plus humain le capitalisme. Telle est bien la fin recherchée, qui ne doit pas disparaître sous le moyen. Car c’est une des difficultés rencontrées par la promotion du temps choisi : le temps choisi se présente simultanément comme une fin (libérer la personne du poids excessif du travail) et comme un moyen (offrir des possibilités de choix au sein du système). Les moyens, si l’on n’y prend pas garde ne sont pas à la hauteur des fins. Ceux qui s’intéressent aux fins, ce qui était le cas de Gorz, se méfient des moyens. Ceux qui ne regardent que le moyen, assimilé au droit au travail à temps partiel, ont tendance à négliger la fin. La crise financière, économique et écologique actuelle peut fournir un appui pour réconcilier ces deux dimensions et d’ailleurs elle y appelle.
Car il faut écarter la tentation d’une vision molle du temps choisi. Cela suppose que le temps choisi devienne une revendication syndicale à part entière et qu’il soit intégré dans la réflexion et la négociation sur la sécurisation des parcours professionnels. Il faut en effet sécuriser le travail à temps partiel choisi, c’est-à-dire assurer le droit au retour à temps plein et éviter toute pénalisation en terme de carrière ou de retraite, voire même le valoriser en tant que tel. Il faut en outre le distinguer du travail à temps partiel subi, faute de mieux, lui-même largement encouragé par l’Etat dans le cadre des contrats aidés. Que l’Etat commence donc par montrer l’exemple ! Que le système statistique public distingue mieux le travail à temps partiel vraiment choisi, d’une part, du temps partiel choisi faute de mieux (le temps « choisi-subi », par exemple parce que les questions de garde d’enfants ne sont pas réglées) et, d’autre part, du temps partiel subi stricto sensu (qui est minoritaire, 35 à 40 % contrairement à l’image que l’on en a). Enfin, il faut se poser la question de l’aide au revenu des travailleurs à temps partiel : faut-il accorder une aide structurelle aux salariés faiblement rémunérés ? Ou une aide d’attente en attendant le retour à temps plein ? La gestion du Revenu de Solidarité Active ne pourra éluder ce sujet.
Cette question n’est pas sans lien avec celle du développement des services de proximité, des services à la personne, auxquels Gorz a consacré de nombreux développements. Ces services doivent-ils être rendus dans un cadre convivial libre, grâce précisément au temps choisi libéré ? Par un nouveau service public bien professionnalisé, à organiser ? Ou par des activités décentralisées, rémunérées, initiées tant par le secteur marchand que par le secteur associatif ? Peut-on concilier les trois formules, les mettre en émulation ? Faut-il choisir l’une de ces formules, ou deux d’entre elles ? Il y aurait lieu d’en débattre davantage et de donner, là aussi, du choix.
Enfin, la société de sobriété créative et solidaire, qui peut constituer une réponse aux crises actuelles, dans la ligne de ce que souhaitait profondément Gorz, implique sûrement une nouvelle étape de redistribution sociale. C’est la condition de son acceptation. La sobriété n’est ni l’injustice, ni l’austérité imposée aux plus pauvres. Elle repose nécessairement sur la justice, thème qui hante la réflexion de Gorz. Mais le revenu d’existence est-il la solution, ou précisément le piège dans lequel il ne faut pas tomber. La Prime pour l’emploi, le Revenu de Solidarité Active (RSA), sont des tentatives de solutions à cette demande latente de redistribution, mais dont on voit les risques : on devrait pouvoir vivre des fruits de son travail (PPE) et le RSA peut favoriser une extension du travail à temps partiel subi (en sorte que la promotion du temps choisi pourrait constituer un moyen de préserver le RSA de ses dérives potentielles). Mais avant de sauter à pieds joints dans l’inconnu du revenu d’existence, il y a d’autres pistes à explorer, qui, de manière surprenante, ne semblent pas intéresser. Il faudrait notamment se poser la question de l’accès de tous aux biens jugés nécessaires à la vie moderne. De fait, nous considérons que chacun, quel que soit son revenu, doit pouvoir accéder aux réseaux qui caractérisent la vie moderne : l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, la télévision, Internet. Mais nous n’en avons pas tirés les conséquences en termes de financement. Ne faut-il pas que l’accès à ces réseaux (non pas nécessairement la consommation) soit financé, non par un tarif, le même pour tous, mais par un prélèvement sur le revenu, variant donc avec celui-ci en hausse comme en baisse, comme il est raisonné par exemple en matière de santé ? Il y aurait là une étape importante dans la qualité générale de notre redistribution sociale et bien des problèmes de vie courante évités pour beaucoup [7].
Quelques réflexions générales pour conclure
La pensée de Gorz est extrême, radicale, excessive souvent. Mais elle a un grand mérite : elle vous oblige à chercher en quoi, précisément, elle est excessive. Plus on est conduit à nuancer sa réponse aux questions qu’il pose, moins on peut échapper à ces mêmes questions, même si on le voudrait, pour sa tranquillité ! Gorz est un éveilleur, un empêcheur de penser en rond.
Il faut aussi s’interroger : Gorz est-il marxiste, en définitive, ou pas ? Où est-il finalement, où veut-il nous mener ? Vers quelle philosophie, quelle idéologie ? Est-il libertaire, ou marxiste ? Il ne s’est en réalité jamais détaché du marxisme, qui imprègne profondément sa pensée, qui se veut critique et systématique. Gorz ne s’est jamais noyé dans le relativisme démocratique et a toujours entendu y résister tout en restant démocrate. Il cherche une vérité enfouie sous l’immanence, vérité qu’il faut exhumer et qui doit conduire à une société juste. Il n’en démord pas. L’intérêt de sa position, sa difficulté aussi, est qu’il se situe dans cet entre deux si peu exploré du cheminement marxiste, le passage de la méthode de conquête et de la pratique du pouvoir à la société idéale. Gorz reste marxiste en ce sens que pour lui, l’être humain est aliéné, incapable de se libérer lui-même, au moins à l’échelle collective, par une sorte de résistance spirituelle de masse. Le progrès des forces productives, l’accentuation du conflit central de classe, lui offrent les possibilités de sa libération individuelle et collective. Sauf qu’il n’y a plus ni prolétariat, ni classe sociale suffisamment organisée, ni même conflit central apparent. Et pourtant, il y a un passage possible vers la société des sujets, qui remplace en quelque sorte le communisme réalisé. La force matrice qui remplace le prolétariat, c’est l’autonomie, mais une autonomie qui doit être entendue à la fois comme autarcie vis-à-vis du système et comme coopération libre entre ceux qui se sont extraits du système. C’est le Marx de la Révolution réalisée que Gorz retrouve ici, formulé autrement. Mais comment passe t-on de l’un à l’autre ? Chez Marx, on a le chaînage lutte des classes – dictature du prolétariat – appropriation collective des moyens de production – planification. Mais Gorz, précisément, conteste brutalement, férocement, l’essentiel de cette mécanique, au non de sa dangerosité démocratique, de son inexactitude sociologique, et de son irréalisme politique. Mais il garde l’objectif intact et se situe bien dans le même cadre de pensée. Il explore diverses solutions : le dualisme d’abord en 1980, la prise de pouvoir de la société civile ensuite (les chroniques de Michel Bosquet), le revenu d’existence enfin dans ses derniers livres. C’est en définitive par l’Etat que l’individu va se libérer de son état, de son état aliéné. Cette évolution intellectuelle était quasiment inéluctable, induite par son système de pensée. Le revenu d’existence inconditionnel est sans doute aujourd’hui la revendication la plus cohérente et la plus logique d’un marxisme conséquent. Voilà le message de Gorz. Message trop séduisant pour que l’on ne mesure pas ses risques anthropologiques et ses limites économiques. Mais le fait est qu’il y a chez Gorz, comme chez Marx, une sorte d’acte de foi dans les possibilités illimitées de l’immanence, qui pose question.
Car en face de désir légitime, d’utopie se dresse la muraille de la parabole du bon grain et de l’ivraie : le mal, sous ses multiples aspects, y compris la méchanceté humaine, est consubstantiel à l’immanence. Il peut être contenu, régulé, il ne peut être éradiqué. Cela n’interdit pas l’utopie, mais la cantonne à des espaces limités et sacrificiels, et la renvoie à un au-delà quant à sa réalisation totale. Le Royaume n’est pas de ce monde, dit l’Evangile, tout en précisant aussi qu’il est proche (ce que les conservateurs ont tendance à oublier). Gorz, comme Marx, croit à la Terre Promise, et d’ailleurs attaque « Misères du présent, richesse du possible » par un vigoureux : « il faut oser l’Exode » (avec majuscule). La langue maternelle du sens n’est jamais tout à fait étouffée et finit toujours par s’exprimer !
D’ailleurs, quelle est la spiritualité de Gorz ? Dans une réflexion de nature fondamentale, comme celle de Gorz, il y a toujours une métaphysique, implicite ou pas : impossible d’y échapper. La question n’est pas sans importance si l’on croit que la promesse démocratique ne peut pas advenir sans une forme adéquate de spiritualité [8]], si l’on admet que nous ne répondrons pas aux défis de ce temps sans mobiliser cette intériorité de masse inconsciente d’elle-même que la modernité a engendrée, si nous ne redonnons pas à la gauche cette spiritualité particulière, ce sens des valeurs vécues qu’elle a peu à peu perdu chez nous.
Gorz ne sous estime pas l’importance de la question religieuse. Il voit bien que le prolétariat chez Marx a pris la forme de l’Esprit chez Hegel, que « la philosophie du prolétariat est religieuse » [9] et que « le prolétariat conserve toujours le mystère de sa transcendance [10] ». Il constate, dans Adieux au prolétariat que « l’unité postulée des nécessités matérielles et des exigences éthiques correspond en fait à un seul type de communauté : la communauté monacale et ses diverses variantes [11] ». Mais il rejette celle-ci pour se résigner au dualisme des activités hétéronomes ou autonomes, car il voit dans ces communautés glissement symbolique plus que suppression des contraintes et sublimation soumise à un devoir d’Amour envers une entité trop vague ou une personne trop déterminée. Sa position est matérialiste. Mais c’est un matérialisme moral, fondé sur la réalisation de soi, pas un matérialisme utilitariste fondé sur la satisfaction de soi. C’est un matérialisme à la fois libre et vertueux, qui fait confiance à l’individu une fois libéré de la servitude laborieuse, comme chez Marx. Un matérialisme fondé sur l’irréductibilité du sujet, « irréductibilité à ce que les autres et la société nous demandent et nous permettent d’être ». Sur une transcendance du sujet en somme, dont il faudrait savoir si elle relève de Sartre ou de Lévinas. Sa vie, modeste, généreuse, conforme à ses idées, fait de lui un militant exemplaire, et mettant souvent en valeur l’exemplarité des autres. Sa Lettre à D. [12] est une sorte de cantique où il cherche à réparer l’injustice qu’il craint d’avoir commis, longtemps auparavant, à l’égard de son épouse, en publiant en 1958 Le traître. Est-il exagéré de voir chez lui un mystique de la relation amoureuse, vraisemblablement exceptionnelle, qu’il a vécue ? Ne rêve-t-il pas en définitive d’une société qui serait (presque) parfaite, à l’image de sa relation avec D ? Ne faut-il pas trouver là l’arcane des liaisons souterraines qui assurent l’unité de sa pensée et de son action, son désir de révolution et son sens du réel ? Il y a en Gorz une aspiration permanente à l’Absolu, qui fonde sa critique et sa radicalité. Et parallèlement une douceur, une grâce, perceptible dans son œuvre, et que l’on sentait dans la relation. Peut être, en définitive, que soutenu d’Eros, il a pu envisager sérieusement la politique comme Agapê.