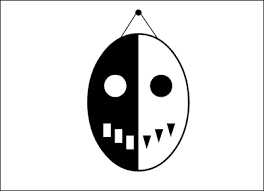L’élection d’Hugo Chavez en 1998 au Venezuela date un basculement quasi général du continent à gauche. Quels sont les facteurs à même d’expliquer ces victoires à répétition ?
Emir Sader. Apparemment ces facteurs sont contradictoires mais, d’un point de vue dialectique, la racine fondamentale est le rejet du néolibéralisme. Durant les années 1990, l’Amérique latine n’a pas été seulement le berceau du néolibéralisme mais son paradis. À cette époque, le continent a la gueule de bois. La réaction épidermique des mouvements radicaux contre le néolibéralisme a conduit à déloger du pouvoir les gouvernements de cette mouvance. On assiste à une réaction populaire contre la politique de la concentration de la rente et de l’exclusion sociale.
Comment ce continent est-il devenu le laboratoire du modèle hégémonique ?
Emir Sader. Les dictatures militaires et les gouvernements de droite ont cassé la capacité de résistance du mouvement populaire. C’est sur cette brisure qu’ils ont construit l’hégémonie libérale. Aujourd’hui, l’Amérique latine a radicalement changé. Jamais la gauche ne s’est retrouvée en meilleure situation. Ce ne sont pas des accidents électoraux mais la généralisation du sentiment de rejet du néolibéralisme. Lors de la prise de fonctions de Fernando Lugo au Paraguay, The Economist a publié un éditorial dans lequel il affirmait qu’il n’y aurait plus de victoire de gouvernements de gauche. Selon ce journal, avec la crise, l’agenda des conservateurs redeviendrait prioritaire avec des sujets, propres à la droite, comme l’ajustement fiscal. Cette analyse s’est révélée erronée avec la victoire de Mauricio Funes au Salvador. Le Front Farabundo Marti (FMLN), comme les autres guérillas, a compris que la fin du monde bipolaire rendait impossible une victoire militaire. Ces guérillas ont donc entamé un processus de transition vers la lutte institutionnelle.
Au Salvador, l’accumulation des forces politico-militaires s’est transformée en un véritable outil institutionnel. Les succès électoraux ont presque été immédiats. Mauricio Funes a déclaré que le président brésilien était une référence importante. Mais il a également annoncé qu’il allait entrer dans l’Alba (1). On le sait, la révolution se fait contre le capital.
En Amérique latine, un gouvernement se construit contre les schémas. Et en Amérique centrale, la chose est encore plus compliquée en raison de l’économie dollarisée. Ce continent est le seul endroit où il existe des processus d’intégration régionaux relativement autonomes des États- Unis. La ligne de démarcation ne se situe pas entre une bonne et une mauvaise gauche, comme veulent le faire croire les médias, mais entre les gouvernements qui ont signé des traités de libre-échange (TLC) et ceux qui sont pour l’intégration.
Néanmoins, des différences notables existent, par exemple entre les gouvernements du Venezuela et du Brésil…
Emir Sader. Très clairement. Ce sont des différences qui se posent à l’intérieur du champ progressiste en termes de pour ou contre le processus d’intégration régionale ou le traité de libre-échange. Le Brésil a joué un rôle très important dans le rejet de l’Alca (2). Chez les pays qui ont opté de manière prioritaire pour l’intégration régionale, certains sont en rupture avec le modèle dominant : Équateur, Bolivie, Venezuela. Les autres ont une politique d’héritage au sens de maintien des éléments hégémoniques du capital financier. Mais ils ont aussi repris l’idée de développement, et surtout amorcé une politique sociale et extérieure différente. Dans le cas du Brésil, il a gardé des aspects importants du modèle hégémonique avec l’agrobusiness. C’est un gouvernement contradictoire.
Justement, comment ces contradictions sont-elles perçues par les forces sociales qui ont porté ces gouvernements de gauche ?
Emir Sader. C’est un mouvement contradictoire avec des secteurs de gauche et des secteurs de droite. Il faut s’allier aux secteurs de gauche pour lutter contre les secteurs de droite. À mon avis, c’est ça la position juste. Il existe une autre vision de l’ultragauche qui consiste à dire que des gouvernements de gauche sont les meilleurs administrateurs du néolibéralisme parce qu’en plus ils ont un soutien populaire.
Comment les forces de gauche et les mouvements sociaux sont-ils parvenus à s’entendre pour remporter des présidences ?
Emir Sader. Il y a une meilleure compréhension de la nouvelle dynamique de la lutte sociale, politique, historique. Si l’on prend le cas de la Bolivie, l’apparition du mouvement indigène, comme sujet central, a été fondamental. Il s’agit en fait d’une nouvelle compréhension théorique du sujet. Le vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Linera, a écrit un article fondamental de ce point de vue. Il y fait la critique de l’économicisme de la gauche traditionnelle en Bolivie. Celle-ci s’adressait aux Indiens en leur demandant de quoi ils travaillaient. « De la terre ? Alors tu es un petit paysan, allié vacillant de la classe ouvrière. » C’est-à-dire qu’il y avait exclusion de l’identité séculaire – Aymara, Guarani, Quechua. Qui plus est, l’analyse était d’autant plus fausse que le travail de la terre des Indiens n’est pas individuel mais communautaire. Le changement de cette vision a permis la construction y compris du MAS (Mouvement au socialisme, le parti d’Evo Morales).
Quel a été le rôle des courants dits plus traditionnels – marxistes, théologie de la libération, féministes ?
Emir Sader. Les mouvements sociaux ont été le principal protagoniste de la résistance au néolibéralisme. Ils ont été prédominants dans les années 1990, à partir des crises économiques comme au Mexique en 1994, au Brésil en 1999, en Argentine en 2001. Ils ont ouvert une période de contestation du modèle hégémonique qui a permis l’émergence d’une alternative. L’élection d’Hugo Chavez en est symptomatique. Les mouvements sociaux qui sont parvenus à se poser la question de la construction gouvernementale ont un fait un bond un avant. Ceux qui sont restés au niveau de la résistance, et n’ont pas rétabli des rapports avec la politique pour disputer le pouvoir hégémonique, se sont essoufflés, voire ont presque disparu.
Quels sont désormais les principaux défis de la gauche ?
Emir Sader. La question centrale est la lutte anti-néolibérale. Elle peut déboucher sur le socialisme et acquérir une dynamique anticapitaliste dans la mesure où l’on procédera à la « démarchandisation » de cet ordre économique. Il s’agit pour les gouvernements de réorganiser l’État et la société autour de la sphère publique et d’ouvrir l’universalisation des droits. Aujourd’hui le plus grand acquis que nous avons en Amérique latine est l’Alba. À l’intérieur de cet ensemble, le commerce ne se fait pas au prix du marché mais selon le commerce juste. Chaque pays donne ce qu’il a et reçoit ce dont il a besoin. Les échanges entre le Venezuela et Cuba sont exemplaires : la médecine sociale cubaine n’a pas de prix, tout comme les programmes d’alphabétisation, le sport. Dans le même temps, Cuba a reçu du pétrole vénézuélien. Le journal de droite argentin, la Nacion, relevait que 18 000 Argentins sont allés dans un hôpital bolivien pour se faire opérer gratuitement des yeux par des médecins cubains dans le cadre de l’opération Miracle (3). C’est ça la solidarité et la complémentarité. L’Alba est l’espace de l’alternative à l’Organisation mondiale du commerce.
Et concernant l’intégration régionale ?
Emir Sader. Il y a eu une très importante réunion de la Banque du Sud. Elle démarre. La monnaie commune avance pour surmonter les mauvaises alternatives de type protectionniste national qui diminuerait les échanges. Il faut protéger la région dans son ensemble, surtout les pays faibles plus durement frappés par la crise. C’est là une voie. L’autre est d’aider à construire une alternative du sud du monde. Nous sommes les globalisés. Le sud du monde devrait se réunir pour avancer sa solution à la crise.
Entretien réalisé par Cathy Ceïbe
(1) Alba : l’Alternative bolivarienne pour les peuples des Amériques est composée de six États (Cuba, Bolivie, Dominique, Honduras, Nicaragua, Venezuela ; l’Équateur est observateur). Elle repose sur une répartition équitable des biens, services et ressources dont dispose chacun des États membres.
(2) Zone de libre-échange englobant l’ensemble du continent voulue par les États-Unis mais en échec.
(3) L’opération Miracle a été lancée en 2004 par Cuba et le Venezuela. Destinée aux Latino-Américains sans ressources, elle a permis d’opérer gratuitement des yeux un million et demi de malades. Depuis, les cliniques ont essaimé.